F. a, je crois, une emprise considérable sur les membres d’ICC et je sens son influence s’étendre lentement jusqu’à moi, d’une manière très trouble, disons même retorse. Je sais qu’elle atteint les autres de la même façon, de biais, avec une inflexible douceur. Il ne s’auto-désigne pas comme meneur mais il fait et on le suit, sans même s’en apercevoir.
7 Avril
Il faut que je comprenne bien une chose : dans ce journal, les faits n’ont aucune importance. À trop vouloir ne perdre aucun détail je délaisse mes meilleures intuitions. Tout se bouscule et je ne sais plus par où commencer. Je raconterai cette semaine pascale quand toutes mes pensées se seront misent en ordre.
8 Avril
« Quoi de plus beau qu'un homme grand et vigoureux, aux épaules larges et musclées, aux mâchoires dures, aux lèvres lourdes — et priant Dieu comme un enfant. »
Journal, Jean-René Huguenin.
10 Avril
(...)
Revenons-en à mon avenir. Doit-on toujours acter ses possibilités d’une indéniable et très tangible réussite scolaire ? Toutes nos capacités doivent-elles devenir rentables ? L’autre soir au Wha, quand je mangeais avec J., A. et F., l’un d’eux a mentionné la passion actuelle d’An. pour l’histoire, racontant que ce dernier l’avait doctement entretenu de Pline le Jeune et Pline l’Ancien, bien qu’ivre au dernier degré dans un bar des tréfonds du port de Toga. Voilà : des fois, je ne suis pas sûre de vouloir autre chose que de savantes discussions de comptoir.
Hier soir j’ai parlé de ces hésitations à F.. Je lui ai dit mon sentiment, celui d’être témoin d’un miracle permanent quand je rentrais : ici les gens ne se rendent plus compte de leur bonheur, tous vivent dans une félicité qui leur échappe parce que pour eux elle va de soi. Rien n’est moins naturel mais c’est tout juste si elle n’est pas devenu un dû. Je ne dis pas : les hivers peuvent être longs mais ils ne seront jamais aussi pénibles que ceux d’ailleurs, or c’est une chose que j’ignorais avant de partir.
Je commençais peut-être à m’en douter un peu les dernières années, je me souviens avoir eu des discussions à ce propos avec Ramatou quand nous remontions manger notre panini au lycée. L’air était pur et le ciel sans nuage, le froid glacial et nous étions heureuses. En Corse j’éprouve parfois une joie de vivre qui ne tient à rien d’autre qu’à ma présence physique sur cette île et je crois que c’est un sentiment partagé par beaucoup d’entre nous. D’ailleurs il y a un passage dans Le Principe de Ferrari qui me semble faire état de cette étrange élan du coeur mais je ne crois pas qu’il ait réussi à exploiter pleinement le potentiel incroyable de cette sensation aussi puissante que mystérieuse. À sa décharge, je reconnais volontiers qu’elle est très difficilement descriptible.
« Mon cousin semblait parfois ployer sous un poids énorme qui menaçait de le terrasser, et il lui fallait fuir, peut-être la canicule et l’incessante frénésie estivale, peut-être la migraine, le souvenir de nuits sordides ou quelque chose de plus sombre dont j’ignorais la nature. Il m’emmenait alors en montagne boire un café sur la terrasse d’un gîte d’étape, dans un ancien village de transhumance que traversait un sentier de randonnée. Nous y passions un moment, dans la fraîcheur des fougères, à l’ombre de grands pins. Mais son humeur restait maussade. Il ne m’adressait pas la parole. Nous reprenions sa voiture pour retourner en ville et soudain, sans que rien le laissât prévoir, au détour d’un virage, apparaissait la mer. Nous dominions le paysage, comme si nous étions suspendus dans l’air limpide, au-dessus de la route en lacets dévalant à pic à travers la forêt vers le golfe éblouissant qui s’étendait mille mètres en contrebas. Mon cousin ouvrait de grands yeux sur ce panorama qu’il connaissait depuis son enfance mais semblait découvrir à chaque fois comme si c’était la première. Il faisait une grimace incrédule, se mettait à sourire et me donnait des petits coups de poing sur la cuisse en disant, putain ! quand même, hein ? incapable d’exprimer avec davantage de clarté le sentiment qui le bouleversait et lui rendait aussi instantanément le goût de vivre, dans lequel il n’était pas difficile de reconnaître une curieuse forme d’amour qui aurait pris pour objet, non un autre être humain, mais une petite partie bien déterminée du vaste monde inerte, et dont, quoique je sois moi-même incapable de le ressentir, je devais cependant admettre l’incomparable puissance. »
Le principe, Jérôme Ferrari.
F., donc, me disait s’être pleinement rendu compte de ce bonheur diffus, inouï et constant; c’est justement ce qui l’avait décidé à ne jamais partir. Pour mon cas il ne s’est pas prononcé trop clairement, jugeant la situation complexe, mais m’a enjointe à ne pas prendre ma décision trop vite. On sait tous que les retours sont définitifs, j’en ai bien conscience. Cependant si continuer mes études à distance était possible… J’avoue avoir parler de mes doutes pour vérifier ce que l’évocation de mon éventuel retour suscitait chez lui. C’était idiot. Je ne pense pas lui plaire autrement que d’un point de vue strictement intellectuel, ce qui équivaut à ne pas plaire du tout à homme, j’en conviens, mais j’étais curieuse de voir sa réaction. J’éprouve pour ce type quelque chose d’assez inédit qui n’est pas une attirance franche, bestiale, à la façon dont un L. pourrait m’attirer (et, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, je reconnais que sa laideur m’attire peut-être plus que sa « beauté enfouie » dont je parlais la dernière fois). F. m’impressionne par la profondeur et l’intensité de sa vie spirituelle qui le coupe radicalement des autres. Il nous, ou disons il les entraine dans son sillage mais s’en retrouve, de fait, loin devant, seul. Je ne sais pas s’il s’est rendu compte qu’il les portait tous à bout de bras. Entendons nous bien, je ne remets pas en cause la croyance des membres d’ICC, loin s’en faut, mais je pense qu’ils restent dans l’ombre de sa foi à lui, qu’elle rejaillit sur eux. C’est une chose si peu moderne, si surprenante. L’extrait du Journal d’Huguenin que je citais le 8 avril n’est pas sans rapport avec l’impression que me fait F.
Quand je l’ai revu pour la première fois, à la liturgie de la passion, il avait grossi et n’était plus habillé comme un jeune docteur en théologie mais en pastore. La barbe qu’il s’était laissé pousser lui donnait des airs de Marc-Aurèle. Je trouvais cette allure un peu frustre rassurante.
13 Avril
« Est-il interdit d’imaginer qu’il existe parmi nous au moins un catholique du temps des cathédrales, que sa foi pourrait encore lancer dans une étonnante expédition spirituelle ? »
Les Deux Étendards, Lucien Rebatet
*
En poursuivant la réflexion sur mon avenir, j’en arrive aux conclusions suivantes : de ces trois années parisiennes je n’ai rien fait, tout du moins rien dont je ne puisse tirer une quelconque fierté. Je n’ai brillamment réussi nulle part, ni produit quoique ce soit en marge de mes études. Je ne suis même pas tombée vraiment amoureuse une seule fois ! Je ne me suis pas non plus fait de nouveaux amis, tout juste quelques copines et copains, que le circonstances approchent et éloignent sans que je ne m’en soucis trop. J’en suis à un point où mon retour en Corse me semble plus que jamais gorgé de promesses. D’autant que les cartes ont été rebattues. Dans l’avion deux jeunes de mon âge étaient assis à coté de moi, deux jeunes qui, à l’époque du lycée, ne m’auraient sans doute jamais adressé la parole; cette fois pourtant ils m’ont clairement identifiée comme l’une des leur et ont, durant tout le vol, rivalisé d’attention à mon égard. J’étais épatée.
Tout le monde cherche son lieu naturel et si j’ai trouvé le mien, si je suis sûre de ne jamais pouvoir mener une vie pleine et heureuse ailleurs qu’en Corse, alors pourquoi m’en priver ? pourquoi me refuser ce plaisir ? La liberté qu’offre Paris ne m’intéresse manifestement pas. Les rencontres que j’ai faites ces derniers mois à Bastia me semblent tout aussi enrichissantes que celles faites sur le continent, si ce n’est plus. Je ne vois rationnellement aucune raison de ne pas rentrer, sinon celle de ne pas peiner mes parents, qui, quand je leur parle de mon retour prématuré, sont dépités. Leur réaction me blesse énormément; je sens une déception immense et je la comprends : ils croyaient leur fille brillante, elle s’est révélée quelconque. En voilà une déconvenue. C’est ce qui m’arrête. Je ne me sens pas le droit de les décevoir à ce point. Je me dis : un an de plus, ce n’est pas si terrible et pourtant je suis prise d’un vertige, mon ventre se noue à l’idée de devoir passer douze mois de plus je ne sais où.
16 Avril
Je regarde une vidéo où l’on voit les supporters du SCB arriver à Paris puis au stade. Au-delà du foot, au delà de la finale, c’est l’ivresse de l’entre soi qui rend ces gens si heureux.
Au coeur des tribunes flotte une petite banderole sur laquelle est inscrit « ESSE NOI », comme ça, en lettres capitales. Elle résume bien les choses. Nous déclarons exister envers et contre tout: tel est notre triomphe.
Pourtant, quelques heures plus tard, ce « nous » si fier n’est plus qu’un agrégat de pleureuses vexées par l’attitude méprisante d’un Thiriez — alors même qu’il incarne tout ce que l’on déteste et tout ce dont nous voudrions nous émanciper. Notre susceptibilité trahit cet éternel complexe du colonisé qui dénigre ses maîtres mais n’abandonne pas l’espoir d’un jour parvenir à manger à leur table.
Ce peuple est simultanément sain et moribond, schizophrène.
« Qui trop parole, il se mesfait. » Chrétiens de Troye
Le problème des rapprochements opérés sur la base d’une connivence idéologique, même si ce n’est jamais chez moi qu’un prétexte, puisque je n’accorde pas ma sympathie au premier pourfendeur de la modernité venu, c’est qu’il est parfois malaisé de basculer sur un registre plus intime, plus quotidien.
J’y pense à cause de F., bien sûr, à qui je voudrais parler de tout et de rien, plutôt que d’être cantonnée dans un registre intellectuel ou politique, voire théologique. Je crois que mon absence d’intérêt pour le concept transparait très bien dans ce journal où, après tout, je ne développe que peu d’idées en tant que telles.
L’idéal serait bien sûr de se taire. Deux choses permettent le silence : la proximité physique et la certitude d’avoir avec l’autre un lien indéfectible, peu importe sa nature. C’est un luxe que je connais.
Avec F. j’ai à la fois envie de lui parler, pour lui signifier ma présence, et le sentiment que cette parole continue me trahit, lui donne une image tronquée de moi — sans mentir on en vient toujours à commettre de petites exagérations, des inexactitudes.
Je parle trop et cela me dessert. À très court terme, ces causeries répétitives risquent de l’exaspérer.
19 Juin.
Je sens qu’un important changement s’est produit dans ma vie depuis cette fameuse semaine pascale mais tout, en moi, demeure encore incertain, comme incapable de déterminer ce qu’à présent je suis. Cette incertitude et mon extrême fatigue — liée à ma maladie qui n’en finit plus de revenir — me rendent plus sensible que je ne l’ai jamais été. L’impression d’être sans cesse au bord des larmes, d’avoir un chagrin inconsolable parce qu’indéterminé, sans objet précis et néanmoins capable de surgir pour un rien.
*
Suzanne. Je n’ai encore rien écrit ici, me semble-t-il, de son hospitalisation, de la dégradation de son état de santé. Je suis allée la voir en tout et pour tout trois fois. La première fut la plus éprouvante, j’en ai pleuré pendant des heures. Avant, pendant, après. Quelque chose d’insoutenable à l’idée qu’elle puisse m’oublier, oublier les uns après les autres ceux qui l’aiment jusqu’à sa propre fille, comme ma grand-mère avait en son temps fini par ne plus reconnaitre mon père. Mais surtout, j’ai peur qu’elle se sente seule et perdue, livrée à elle-même dans cet endroit qu’elle identifie mal (l’hôpital qu’elle confond souvent avec l’appartement de Papa ou le village), envahie par ses pensées décousues et angoissantes. Depuis, chaque fois que je pense à elle, je ne peux m’empêcher de pleurer et je pense à elle toutes les nuits. Je suis inconsolable.
La dernière fois que je lui ai rendu visite elle dit à Mattea, me désignant « regarde là, décidément entre nous il y a quelque chose, à chaque fois que je la vois je suis au bord des larmes ». Son sourire fragile. Mon coeur se serrait; j’éprouvais de façon aussi simultanée que paradoxale la crainte de la perdre et la peine de l’avoir comme déjà perdue. Insoutenable. L’effort surhumain qu’il me fallut faire alors pour ne pas éclater en sanglots.
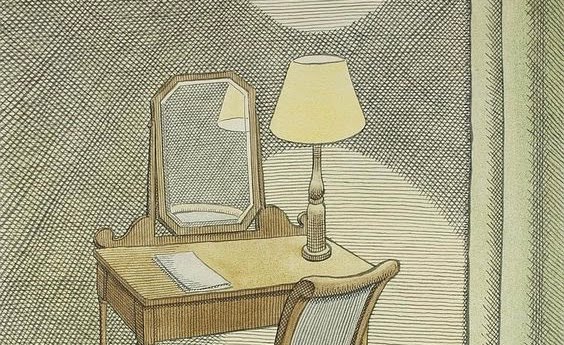
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire