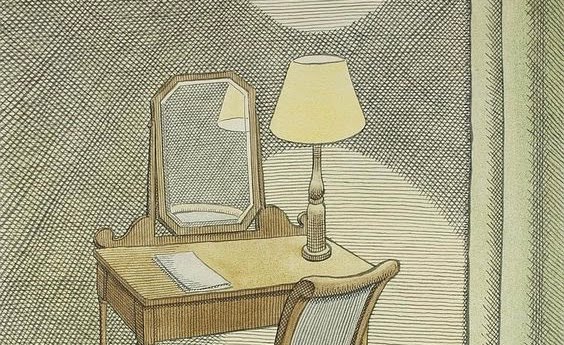9 octobre 2013
Ce sentiment indescriptible d'être à sa place et d'en avoir pleinement conscience, cette joie discrète, quotidienne, sereine, sans tapages ni effusions qui m'accompagne partout depuis le début de l'année et que rien ne semble pouvoir ébranler : j’ai rencontré mes études, comme disait P. Quelque part je lui dois une fière chandelle, c’est lui qui m’a fait comprendre mon erreur - j’ai seulement refusé un temps d’admettre que c’en était une. J’aurais pu rester en droit, refaire une première année, l’obtenir, continuer dans cette filière et finir je ne sais où, n’importe où. On dit le droit mène à tout, j’entends le droit mène nulle part. Continuer en droit c’était refuser de choisir, refuser de m’investir, refuser d’y aller vraiment, sans retenue, comme je vais aujourd’hui à l’université avec la certitude que ce temps là ne déborde pas sur ma «vraie» vie, ne lui enlève rien, mais que les deux se confondent parfaitement.
X m'impressionne terriblement. Je ne me sens jamais à la hauteur des gens qui me plaisent. Ce qui m'intimide le plus chez lui c'est qu'il a l'air, et c'est bête à dire, de connaître la vie, de maîtriser un certain art de vivre qui lui donnerait "un prestige considérable" comme dirait Nimier dans un tout autre contexte. Et il me semble que les hommes comme lui ne sont pas faits pour fréquenter des filles comme moi. Par fréquenter je n'entends pas sortir avec ni rien de ce genre, je l'emploie dans son sens le plus élémentaire, mais même ça, rien que ça, c'est déjà contre-nature. Comme Y qu’on envisage mal en compagnie d'autres types de filles que celles avec qui il publie des photos sur facebook.
19 Octobre
Ce matin longue discussion avec Christine, en partie sur ma mère, sur cette manière qu’elle a d’être ingénument égoïste. Quand Leila me demandait «mais qui elle veut faire chier là ?» et que je lui répondais «personne», j’avais raison, il n’y a chez elle aucune volonté de nuire, juste la peur d’affronter les choses en face, de s’impliquer, d’être contrariée.
Ma mère me fait l’effet d’un courant d’air, jamais constante, sans but précis, avec pour simple boussole ses envies, ses caprices. Elle m’aime, je ne peux pas croire qu’elle ne m’aime pas, mais dans les limites de son possible à elle, qui ne sont pas celles de mon père. En fin de compte le plus gros défaut de ma mère c’est mon père : si je ne pouvais pas les comparer l’un à l’autre, sentir que les sacrifices faits par mon père sont trop grands pour être justes, alors peut-être que je ne me serais encore rendue compte de rien.
26 Octobre
Il est 3h30 du matin, je suis censée prendre l’avion dans quelques heures. (...)
Et mon lave-linge fuit, voilà autre chose. Je m’en suis rendue compte il y a environ vingt minutes, j’en ai pleuré. Je me sens prisonnière, prise au piège à Paris, je voudrais pouvoir me reposer dans les bras de mon père, me laisser aller, arrêter d’avoir toutes ses responsabilités d’adulte qui pèsent sur mes épaules et redevenir sa fille, je veux dire comme avant mon départ, comme quand on est enfant. J’attends qu’il soit six heure pour l’appeler. Je n’ai pas envie de rester ici et pas envie de partir. Je ne sais pas quoi faire. Cette nuit rien ne va.
*
Rencontré plusieurs personnes à la fac à cause de l’absence du tuteur. Juliette et Félix, d’abord. Juliette a ce drôle d’aspect à la fois vieux jeu et très enfantin, de ces enfants que l’on juge immédiatement un peu bizarres parce qu’étrangers aux modalités de la vie sociale, décalage dont on se rend d’autant mieux compte qu’on est un adulte et qu’on observe tout ce manège de loin. On ne sait jamais quand elle va parler ou rire ni encore moins ce qu’elle va dire, c’est un peu déstabilisant mais plutôt touchant. Qui plus est elle s’est avérée être drôle, ce qui n’est pas rien.
Félix est suédois, il parle un excellent français et je le devine très intelligent. Quand on le voit on l’aime déjà ; son côté grande santé, pleine forme des gens venus du Nord. Il est simple, souriant, sa gestuelle souple. Il dit toujours des choses pertinentes. À un moment on s’est mis à parler cinéma, je disais que j’aimais Bette Davis, que c’était celle qui jouait dans All About Eve, et il a dit «ah oui d’accord» et on s’est mis à citer en coeur la fameuse réplique culte «fasten your seabelts, it’s going to be a bumpy night» sans ce côté prétentieux des cinéphiles, je crois, mais un peu à la manière dont Élodie ou Lara aurait dit «Voiiiituuuuure - Engaaagemeeeeent» il y a de ça quelques années maintenant : avec un sourire entendu mais sans s’y attarder.
Enfin une troisième fille dont j’ai oublié le prénom et qui est en seconde année, très intéressante. Le premier jour je l’avais crue un peu psycho rigide, du genre à souligner ses titres avec une règle - alors qu’il ne s’agissait que d’un cours de tutorat, autrement dit du vent. Mais en fin de compte pas du tout. Après avoir fait plus ample connaissance je l’ai trouvée adorable, bienveillante, j’avais envie d’en faire ma copine. À un moment on discutait de nos profs, j’évoquais C. et elle m’a dit d’un air réellement mélancolique (avec peut-être une légère crainte de me faire de la peine) «mais tu sais... il paraît qu’ils font ça tous les ans» j’ai ri et répondu que oui, j’étais au courant, et elle a ajouté «moi ça m’a abattue de l’apprendre» comme un peu surprise par ma gaité, alors j’ai entamé le refrain classique du si tu savais à quel point moi aussi ... mais je m’y suis faite.
L’an dernier elle avait un prof commun avec David, j’ai voulu savoir si par hasard elle se souvenait de lui ; elle m’a demandé s’il était brésilien, j’ai dit non, mais que je me souvenais avoir justement parlé d’un brézilien avec David qui était aussi dans ce cours et qui lisait Kierkegaard, elle m’a dit oui, voilà, et on s’est comprises.
*
En Italien Alice m’interroge : «tu rentres en corse pendant les vacances ?» je réponds oui, elle me dit «eh oui... moi aussi je rentre dans mon trou». Je n’avais plus envisagé la corse comme un trou depuis bien longtemps mais je n’ai pas protesté.
28 Octobre
Après de nombreuses péripéties j’ai fini par arriver dimanche à Bastia. Aujourd’hui j’ai acheté des robes du vernis et mon parfum. Pas travaillé.
Hier travaillé trois heures et croisé entre autres madame M. Elle m’avait laissé un souvenir étincelant, celui d’une femme brillante et passionnée, excellente professeur : hier elle avait ses deux enfants avec elle, l’air fatigué, usé, je me suis dit c’est ça la fatigue des profs, cette espèce de voile qui les embaume, même les meilleurs finissent par y passer et voilà ce qui m’attend.
3 Novembre.
(2:50 du matin) Je suis enfin revenue sur Paris. Moments marquants du séjour : mon père et moi devant le tombeau familial, silencieux, lui sans doute perdu dans ses souvenirs et moi saisie par le regret d’en manquer ; ma mère, au bord des larmes, se sentant prise au piège (...), est-ce qu’elle regrettait d’avoir à être mère à ce moment là ?
*
Thomas m’a fait l’oghju, il a dit n’avoir jamais vu de l’huile se dilater aussi vite. C’était pour ça que tout allait tellement de travers ces temps-ci.
*
(..) On voudrait leur dire mais fermez là où je vous fais avaler vos dents ! Mettre un bon coup de tête et leur rappeler à quel point ils ne sont qu’une bouche et la moitié d’un cervelet. Voilà ce qu’ils méritent.
Ça a beau me mettre les nerfs je continue de les lire tout en pensant à ces deux jeunes croisés furtivement sur la route du village. Tous les deux appuyés contre un 4x4, l’un en débardeur l’autre en t-shirt noir, ils étaient immobiles et j’avais l’impression qu’ils étaient à la fois déjà là il y a 100 ans et en même temps là pour toujours. Comme ils étaient beaux, contrairement aux affreux dont je parlais tout à l'heure.
4 Novembre.
Revu Felix et Juliette, toujours la même complicité immédiate, y compris avec un de leur ami. Felix m’a demandée si j’avais vu que Théorème passait à la cinémathèque. Ça me plait beaucoup, ces gens me plaisent beaucoup. Je suis la première à m’en étonner du reste. Longtemps que je n’avais plus ressenti d’enthousiasme pour des gens. Je veux parler d’un enthousiasme doux, pas d’un rapprochement éclair qui retombe aussitôt, pas de ceux qui s’estompent après deux semaines, pas des «mais au fond qu’est-ce que j’en ai à foutre ?» au bout de quelques jours. Eux n’attendent rien de moi, je n’attends rien d’eux et je les trouve charmants. Voilà tout.