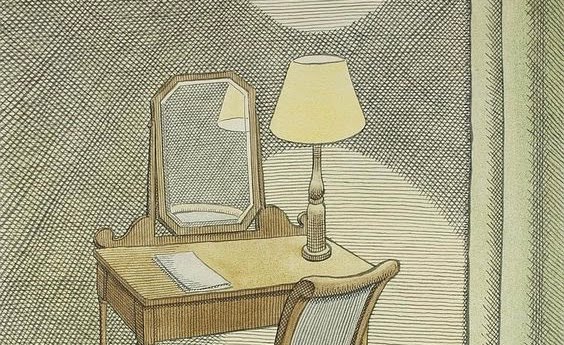Aucun mot ne semble assez fort pour circonscrire ma douleur, elle est à la fois trop grande et trop profonde pour se laisser saisir. Je n’avais plus ressenti un tel déchirement depuis la séparation de mes parents, quelque chose de si radical qu’il nous laisse idiot devant le fait accompli, irrévocable.
Du jour où je suis pour la première fois allée la voir à l’hôpital, à Oletta, j’ai su qu’il ne me restait plus qu’à attendre sa mort, à la regarder m’oublier puis mourir. Je la revois sur ce lit, un lit si bas, collé contre le mur de cette petite chambre d’hôpital que je jugeais indigne d’elle, et sa voix avait changé, ses intonations n’étaient déjà plus les mêmes et je ne savais pas si elle délirait momentanément ou si désormais elle ne serait plus que comme ça. Ce jour là je l’avais déjà perdue et j’en avais conscience.
Elle avait mal, je voyais sa souffrance et je me souvenais de cette nuit où, chez mon père, je l’entendais tousser de ma chambre et j’avais peur qu’elle meurt, tellement peur qu’après être allée m’assurer que tout allait bien j’en avais pleurer toute la nuit; cette nuit là était un avant-goût, un pressentiment de tout ce que je vis aujourd’hui.
Mon été tout entier était le prolongement même de cette nuit, une perpétuelle angoisse de la perdre et pourtant la connaissance du caractère aussi proche qu’inéluctable de sa disparition. Elle allait mourir et je ne pouvais que lui prendre la main et me retenir au mieux de pleurer en sa présence. Je me souviens d’un jour où, allant la voir dans la salle commune de sa nouvelle maison de retraite, j’avais détourné d’elle mon regard pour qu’elle ne voit pas mes larmes et j’avais croisé le regard bienveillant d’une autre patiente, en bien meilleure santé qu’elle, qui semblait compatir à ma douleur. Elle me souriait discrètement et j’ai pensé qu'elle avait peut-être pu sentir tout l’amour que j’avais pour Suzanne, voir la pureté et la beauté de notre amour.
Depuis sa mort je me repasse sans cesse ces scènes et toutes les autres, celles de mon enfance et les derniers moments passés avec elle dans la maison du village.
Elle n’est plus nulle part dans le monde. La radicalité de cette pensée me donne le vertige. Elle n’est pas juste loin de moi, elle n’est plus là. Je sais qu’elle est au ciel et je devrais être apaisée à l’idée qu’elle puisse, de là-haut, veiller sur moi, mais je suis juste anéantie à l’idée de ne plus la savoir à portée de main. Je voudrais l’embrasser et l’entendre. À l’enterrement avant que l’on ne referme le cercueil j’ai refusé d’aller lui faire un dernier bisou. Je m’en veux terriblement aujourd’hui. Ce n’était que son corps mais c’est précisément lui qui aujourd’hui me manque tant. Je crois en Dieu, à la vie après la mort, pourtant aujourd’hui c’est sa présence physique que je voudrais retrouver.
Dans 13 jours j’aurais 22 ans, ce sera mon premier anniversaire sans elle, la première année de ma vie sans la femme qui m’a tout offert. Un jour je me suis demandée si j’avais reçu d’elle un héritage immatériel, comme on dirait qu’on hérite des traits de son père et du caractère de sa mère. La réponse est oui. J’ai tout reçu d’elle. Ce que je mets parfois abusivement sur le compte de la génétique vient en fait d’elle et plus assurément encore si j’ai un jour eu une once de confiance en moi c’est d’abord grâce à sa tendresse et l’attention qu’elle m’a toujours donnée.
Il n’y aurait pas assez d’une vie pour dire à quel point je l’aimais et ces mots seraient de toutes façons superflus. Nous n’avions besoin que d’un regard pour nous exprimer l’amour que nous éprouvions l’une pour l’autre et je sens que tout ça mérite de rester dans l’intimité de notre relation, secret.
Aujourd’hui quelque chose en moi me dit qu’elle ne voudrait pas que je sois si malheureuse. Et je veux rester fidèle à mon amour pour elle, pas à ma douleur.
14 Mars
Retrouver cette citation sur un billet de mon blog datant du Jeudi 9 Août 2012 :
"Bien sûr, les choses tournent mal, pourtant, tu serais parti et, quand l’étreinte du monde serait devenue trop puissante, tu serais rentré chez toi. Mais ça ne s’est pas passé comme ça, car les choses tournent mal à leur manière mystérieuse et cruelle de choses et font se briser contre elles toutes les illusions de lucidité. Tu es parti, le monde ne t’a pas étreint et, quand tu es rentré, il n’y avait plus de chez toi." Un Dieu un Animal, Jérôme Ferrari.
«Le monde ne t’a pas étreint » cette formule est idéale pour résumer ces quatre années parisiennes. À vrai dire je ne sais pas si le monde ne m’a pas étreint ou si j’ai refusé de me laisser prendre mais lui et moi nous sommes manifestement manqués.
Dans la suite du billet je dis que c’est l’orgueil que nous tirons de nos origines qui nous poussera, le moment venu, à rentrer. Aujourd’hui je sais que c’est l’inverse : l’orgueil nous aide à partir, nous donne la force de quitter l’île mais c’est une certaine forme d’humilité qui nous amène à comprendre que nous ne sommes que de là et que l’on se doit, modestement, d’y retourner prendre notre place.
15 Mars Samedi je suis passée à la galerie avec Priya. Je lui ai dit « on se sent bien ici non ? » et elle m’a répondu « bien sûr que tu te sens bien, toi au milieu de tes pairs ». Il n’y avait pas d’agressivité dans sa voix, ce n’était pas un reproche, mais j’étais surprise par sa remarque, un peu vexée même.
Depuis que je fréquente la bande de N. je ne les ai jamais identifiés comme étant mes pairs et d’ailleurs je pense qu’il en va de même pour eux à mon égard. Ils sont tous tellement parisiens — à part N. et éventuellement A. — qu’aucun d’entre eux ne survivrait plus de dix minutes en milieu rural. C’est à mon sens suffisant pour les discréditer. Au fond je leur trouve un raffinement dont je suis dépourvue, mais un raffinement qui n’aurait rien d’une pure élégance, qui serait au contraire plutôt comme suranné et gauche : un raffinement de fin de race.
Je n’éprouve aucun respect pour les frères V. ou pour V., ils me dégoutent même un peu. C’est surtout comme s’il n’y avait rien à dire sur eux, comme si leur existence était si faible, leur présence au monde si insignifiante que mon regard, à moins que je ne le stoppe volontairement, que je ne lui ordonne d’y faire attention, pourrait passer et repasser sur eux sans jamais les voir, sans jamais rien leur trouver de remarquable, au sens propre du terme. Ils sont l’inverse absolu de M-E N, ses parfaits négatifs, ce qui lui donne d’autant plus d’éclat.
20 Mars
La date anniversaire de ma conversion approche.
J’ai du mal à évaluer le chemin parcouru depuis un an, à cerner celle que je suis devenue maintenant que je crois en Dieu et pratique ma foi.
Je pense que j’ai toujours creusé mon identité dans un unique sillon, sans jamais dévié et que la semaine pascale 2015 a été le point d’orgue d’un long cheminement où ce que j’avais toujours cherché s’est enfin dévoilé, me donnant la force d’assumer pleinement le choix de mes orientations les plus intimes et d’être en phase avec moi-même. C’est un accomplissement qui ne saurait connaître aucune dénégation, comme si j’avais jusqu’alors avancé à l’aveugle et que je voyais désormais l’ultime fin, le bout du tunnel, auquel je ne pouvais plus tourner le dos.
Quand je vais à Saint Nicolas je trouve ceux qui ont hérité de ce que j’ai dû découvrir par mes propres moyens très beaux. Quelque chose dans l’élancement de leur physionomie, la grâce de leurs gestes ou la pureté de leurs traits nous laisse deviner à quel point ils ont été protégé d’une certaine laideur contemporaine, mis à l’abris par une solide éducation inspirée de saines valeurs. J’envie parfois leur assurance, celle donnée par la certitude d’être d’un milieu sécurisant et de ne jamais vouloir en sortir. Ils représentent quelque chose de noble et d’intemporel.
Ce matin nous célébrions les Rameaux et près de 600 personnes sont entrés dans l’église après une courte procession depuis la place Maubert; tandis que nous marchions dans la rue en chantant le Gloria les gens nous regardaient toujours étonnés, parfois émus, comme s’ils redécouvraient soudainement ce qu’avait été leur pays et qu’une petite frange de la population continuait par miracle d’incarner, dans l’ombre. Notre ferveur était palpable et aucun de ceux que nous croisions ne s’y trompait. J’étais heureuse d’en être, d’avoir fait l’effort de me lever et de descendre alors que ma paresse avait bien failli m’en empêcher. Il n’y a pas que ça. Parfois le dimanche matin ce n’est pas l’envie de dormir mais une sorte de honte, celle de n’être pas encore assez bonne catholique qui, paradoxalement, me retient d’aller à la messe. Parfois je cède. Pourtant quand je me force je suis toujours récompensée et aujourd’hui, en plus d’avoir assisté à une messe somptueuse, j’ai passé une excellente après midi, très enrichissante, en compagnie de J. et deux amis à lui — dont je parlerais peut-être plus longuement une prochaine fois — ce qui, évidemment, n’aurait jamais été le cas si je m’étais recouchée.
21 Mars
Comme L. était de passage à Paris nous avons passé la journée ensemble. J’aime la façon dont il se comporte avec moi, il est le seul à se montrer tactile, protecteur, à ne pas me réduire à mon intelligence ou ma culture, à voir en moi quelque chose comme une enfant quand tout le monde salue — et de tout temps — ma remarquable maturité. Avec lui je me sens le droit d’être légère et idiote sans risquer d’être méprisée.
Dommage qu’il puisse par ailleurs se montrer si peu capable d’auto-discipline, souvent capricieux et ingérable. Mais je ne supporte pas pour autant la manière dont F. et les autres parlent parfois de lui, comme s’il était perdu. Je prendrai toujours sa défense.
26 Mars
J’ai laissé beaucoup de mes amis s’éloigner sans permettre à d’autres de s’approcher; je me retrouve donc aujourd’hui avec une constellation de gens qui ne s’avanceront jamais au-delà d’un certain point, d’un certain degré d’intimité. Je suis seule et prise au piège. Je voudrais être de nouveau entourée, protégée, choyée par ceux qui vous aiment en l’absence de tout lien du sang, de toute obligation héréditaire : gratuitement.
Je ne me sens même plus négligée par les autres mais carrément négligeable. L’impression que le monde pourrait me balayer d’un revers de main sans que cela ne s’en ressente.