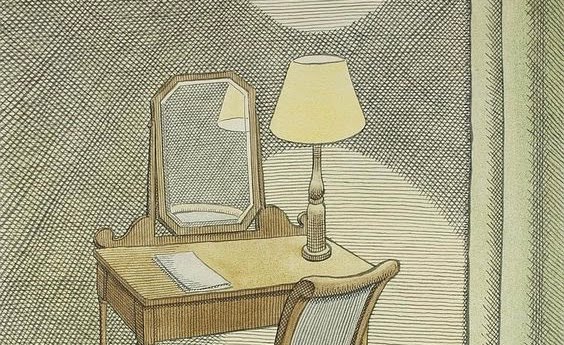jeudi 29 juillet 2021
dimanche 21 août 2016
2 Juin 2016Nous sommes le deux juin, le ciel est gris et la seine déborde. Je regrette d’autant moins de quitter cette ville qu’elle me refuse des derniers jours cléments au coeur d’une période d’ordinaire si charmante. Je pars donc sans regrets, sinon celui de n’être pas encore devenue, après ces quatre années parisiennes, celle que j’aurais voulu être à l’âge qui est le mien. Mes espérances étaient pourtant floues mais j’ai bien conscience de les avoir déçues.
L’ère qui s’ouvre n’en est que plus prometteuse : tout reste à faire.
Papa et maman veulent m’acheter un appartement. Quelque chose me gêne dans une telle aisance financière, dans leurs efforts pour me mettre à l’abris du moindre danger, pour me « constituer un patrimoine ». L’expression est si laide. Je sens trop qu’un jour leur bonté m’étouffera. Le moment venu ces facilités m’empêcheront de prendre les bonnes décisions, de faire des choix radicaux mais nécessaires. Je refuse toutefois d’avoir honte de ma qualité de bourgeoise et même de la renier — tout reniement est une impasse. Pourtant je vois l’étau du confort se resserrer et une part de moi s’alarme. Donc je freine l’entreprise, je dis : réfléchissez bien, pas trop cher, pas trop grand, ne me faites pas encore culpabiliser de vous couter si cher etc. Ils répondent « tu es notre seule enfant » et un poids colossal s’abat sur mes épaules.
6 Juin. Mes derniers jours à Paris sont résolument mornes. Le temps est désormais étrange. Même lorsque la lumière du soleil perce le ciel reste couvert, l’air est lourd et quelque chose m’empêche de respirer normalement.
Je sens trop que rien ne me manquera; ou du moins jamais de la façon dont la Corse m’a manquée pendant ces dernières années — c’est à dire cruelle, vitale.
La Corse n’entretient pas les illusions. Si vous y êtes malheureux c’est impossible de croire qu’un évènement merveilleux va soudainement venir bouleverser votre vie, briser malgré vous la routine dans laquelle vous vous êtes installés. Vos possibilités dans toute leur étendue sont là, face à vous, vous les connaissez toutes et rien ne peut plus venir vous surprendre. À Paris au contraire on a toujours l’impression d’être au bord de quelque chose, d’un changement capital… qui n’arrive jamais ici non plus, mais l’espoir demeure tenace et est entretenu par les gesticulations constantes des autres autour de nous. En Corse chaque chose est à sa place et vous aussi.
Il me faudra donc donner le ton dès le début. J’essaie de me mettre dans un bon état d’esprit, moins coincé et plus combatif que d’habitude. Je repense à toutes les fois où j’ai été jeté dans un environnement nouveau (en l’occurence celui-ci le sera aussi parce qu’entre 18 et 22 ans les cartes sont rebattues, les équipes reconstituées, le paysage social chamboulé), au temps que je perds à croire que je ne mérite pas les gens que j’apprécie alors qu’ils finissent généralement par venir vers moi. Au CS une fille qui s’appelait Sarah et avec qui j’aurais dû rester dès le début m’avait dit que leur bande se demandait pourquoi j’avais si longtemps trainé avec les débiles à mon arrivée au centre. Je n’avais pas oser lui répondre que c’était par peur qu’eux ne veuillent pas de moi. Je garde cet échange en tête.
Je n’arrête pas de penser à la discussion d’Alcibiade et Socrate à propos de l’accord des gens qui composent la citée, sur quoi doit-il tenir ? Aucun savoir en particulier. Donc sur quoi est-on d’accord ? D’où naît la philein qui unit les citoyens ? Peut-il y avoir philein sans accord ? Comment ? Je suis restée bloquée sur ce passage. À partir de lui et des conceptions française et allemande de la nation on peut réfléchir à la situation de l’Europe actuellement — et à la saison 6 de The Walking Dead. Il faudrait que je prenne sérieusement le temps d’écrire tout ça.
14 JuinJe suis rentrée en Corse. Nous avons trouvé l’appartement et je ne m’en plains plus. Il me servira. Il est situé dans une rue merveilleuse du vieux Bastia, une rue préservée de tout comme on n’oserait même plus en rêver ailleurs. Une rue comme celle dans les premiers Nanni Moretti.
D’ailleurs maman est partie cette semaine pour Rome faire son documentaire sur la liturgie, je me retrouve donc seule à la maison. Tout est très tranquille. Je lis jusqu’en fin d’après-midi puis je pars voir mamie. Toujours un peu peur de la trouver trop affaiblie, de revivre le cauchemar de l’été dernier. Je sens qu’elle n’a plus envie de vivre. Chose plus étrange encore j’ai progressivement vu cette volonté la quitter. Il n’y a pas si longtemps Nana et elle s’étreignaient avec force, et Nana ne cessait de répéter « on est toujours là Hortense ! On est toujours là ! ti rendi conti ?! ». Mais aujourd’hui je sens que ma grand-mère se rêve déjà ailleurs.
Mariage d’Émilie et Paul, il y a deux jours. Je l’attendais comme le premier vrai évènement de l’été.
Je me sentais étrangement loin de tout, mal à l’aise dans cette famille qui m’est devenue proche si vite mais que je connais encore si mal.
Le soir lors de la réception un groupe jouait des chansons très à gauche — comme Bella Ciao, Commandante Che Guevara, ou même du Tryo. Je me demandais ce qu’ils pouvaient bien ressentir avec un tel répertoire devant des femmes portant des sacs Chanels et des carrés Hermès qui mangeaient des petites vérines sans leur prêter la moindre attention, sinon pour dire à leur voisine « la musique est un peu forte, non ? ».
Je regardais tout de loin. Je n’avais rien à dire. Il me semble d’ailleurs qu’en leur compagnie je perds toujours toute répartie. Jamais rien d’intéressant ni de drôle ne sort de ma bouche. Ils doivent penser que mon père est fou de dire tant de bien de moi.
Enfin la composition de notre table était tout de même savoureuse. Mettre un ancien de la BAC à coté d’un ex du grand banditisme international, le premier ignorant tout du passé du second… Génie.
J’ai aussi été témoin d’une scène intéressante, qui m’a rappelé quelque chose que j’oublie souvent : la bêtise est parfois généreuse. Il y avait la fille de G. J’ai vite compris que ce n’était pas une flèche. Je ne dis pas que c’est une demeurée mais elle a sans doute été élevée, par sa mère, dans des conditions telles qu’elle n’a pas pu se développer pleinement. Le fait est : les enfants avaient préparé — avec la femme qui s’occupait d’eux pendant la réception — une petite chorégraphie, et, au moment de l’effectuer, tous les adultes, parents mis à part, les regardaient las et pressés de pouvoir continuer leur discussion et leur repas. Mais la fille de G. était debout et les applaudissait, les encourageait. Je sentais que c’était un élan de générosité pure qui n’était dû qu’à sa simplicité et qui nous renvoyait tous autant que nous étions à notre sécheresse. Nous ne nous soucions pas le moins du monde du plaisir de ces enfants. Nous pensions « ils ont l’air cons à gesticuler comme ça » ou « mais à quoi ça sert ? » en ayant hâte que tout ce cirque prenne fin.
Finalement je suis rentrée très tôt avec le sentiment d’avoir quelque part manqué à mon devoir. J’aurais voulu faire meilleure impression, être plus souriante et sympathique, tandis que je n’avais été qu’égale à moi-même, c’est-à-dire renfermée et taciturne.
9 Juillet Je n’ai plus écrit depuis presque un mois et pourtant bien des choses se sont passées quoique je n’en garde presque aucun souvenir.
Je suis retournée à Paris vider mon appartement. C’était pénible mais je pensais : après ça tout sera vraiment terminé. Envie de couper les ponts avec cette ville et la France en général. Ne plus regarder ce qui s’y passe, ne plus me sentir concernée par elle: conquérir une autonomie mentale. J’avais prévu de revoir beaucoup de monde mais finalement je n’ai fait qu’un déjeuner avec Sarah (qui part au Québec l’an prochain) et Regina (qui reste à Paris et viendra vite me voir, j’espère). J’y ai appris des choses croustillantes sur Monsieur S., notamment qu’il avait eu une relation un peu trouble avec Marie avant de prendre peur et de lui demander de garder ses distances. Évidement il ne s’est rien passé entre eux mais… contrairement à ce que disait Sarah je ne pense pas que Marie soit la seule responsable de cette ambiguïté. S est tellement sensible au regard que les élèves portent sur lui, qu’il s’est sans doute laissé grisé par l’admiration de Marie.
Il a toujours fait une forte impression sur moi aussi, mais je n’ai jamais trop voulu m’en approcher. Pour me toucher les profs doivent rester loin, c’est une règle intangible.
Après quoi je suis rentrée et nous avons enterré Yolande. Enterrement étrange, personne ne pleurait trop, et surtout deux de ses petits enfants (qui incarnent d’une manière providentielle tout ce que mes cousins détestent : « gros français », écolos, végans, féministes, « sales », de gauche, etc.) ont parlé. Pour bien faire il faudrait mettre un point d’exclamation : ont parlé ! tellement la chose semble inconcevable. Mais il parait qu’en France cela se fait, les gens viennent parler de ceux qu’ils ont perdu et pleurer devant l’assemblée. Ma foi. La démarche me semblait mal venue pourtant je dois reconnaitre que dans la froideur ambiante elle a mis un peu d’humanité.
Le même jour une crise d’hystérie a secoué ma famille parce que Maman voulait envoyer mamie à l’hôpital et les autres trouvaient que c’était exagéré, qu’il fallait arrêter de l’envoyer aux urgences pour un oui ou pour un non, qu’elle était vieille et voilà tout. Moi j’étais très affectée alors j’essayais de résonner maman d’un coté en communicant discrètement avec le reste de la famille de l’autre et je voyais ma mère se décomposer à mesure que nous nous rapprochions de Bastia. Dans la voiture mon père prenait mystérieusement la défense de mère, ce qui m’était plus insupportable que tout, et il ne me restait que quelques heures pour envoyer mon dossier d’inscription à la fac. La tension devenait insoutenable.
Puis des jours ont passé sans que rien de notable ne surviennent, puis Fred et moi sommes montés voir la petite Isabelle à San Martinu. A. s’est montrée très honnête sur la maternité alors que ses opinions auraient pu la pousser à dire tout l’inverse.
Je suis d’ailleurs excédée par tous ces articles sortis récemment qui disent qu’être mère est une plaie parce qu’on sent trop le message sous-jacent : cet enfant est une entrave à mon épanouissement qui ne trouve sa raison d’être que dans mon égoïsme. J’avais lu un article sur des femmes qui allaient jusqu’à exprimer sur facebook, dans un groupe dédié, leur regret d’être mère. A. disait s’être rendue compte de manière très abrupte de la difficulté de s’occuper soudainement d’un être qui dépend entièrement de vous quand on ne s’est, pendant toute sa vie d’adulte, jamais soucié que de soi et de son couple. Et c’est vrai qu’il ne faut rien idéaliser. Mais regretter d’avoir des enfants, aller jusque là, pour moi, relève de la maladie mentale. Pour A : je pense qu’une fois la période de transition passée tout rentrera dans l’ordre.
Ensuite Fred et moi sommes partis à Florence, un jour seulement, pour voir une messe d’ordination célébrée par le cardinal Burke. Les prêtres étaient issus de l’Institut Christ Roi et je pense qu’au moins cinq des onze ordonnés étaient français donc dans l’Eglise tout le monde ou presque l’était également. (Il y avait même JMLP !)
La cérémonie a duré quatre heures. Les chants étaient magnifiques et l’entrée du Cardinal avec sa capa magna en imposait mais je dois dire que je n’ai pas particulièrement été touchée. Tout m’avait l’air un peu trop baroque, un peu trop grandiose. Évidement l’occasion commandait cette débauche de moyens mais elle me laissait insensible. Et puis il faut dire ce qui est, quatre heures, comme ça, dans une chaleur infernale, c’est très long. À un moment j’ai fini par être obnubilée par mon inconfort, je n’arrivais plus à penser à rien d’autre et de fait la grâce ne pouvait plus opérer.
Par la suite nous sommes allés manger puis nous nous sommes un peu promené avant de reprendre le train. Il faisait 36*, j’avais des ampoules sous les pieds.
(...)
Note sur Livourne : une chose très rassurante dans cette ville qui a pourtant l’air damnée, les gens semblent très peu préoccupés par leur emploi mais tout disposés à vivre. On dirait qu’ils n’occupent aucun poste, leur moyen de gagner des sous parait être un aléa plus ou moins heureux qu’ils accomplissent souvent de mauvaise grâce, ou avec beaucoup de distance. L’air de dire je suis là parce qu’il le faut mais bon ma vie est ailleurs. J’aime cette indolence. En France on a toujours l’impression inverse, les gens mettent tout ce qu’ils ont dans leur métier, c’est ce qui les résume entièrement.
18 Juillet
Attentat de Nice il y a quatre jours, un autre petit en allemagne ce soir (une attaque à la hache dans un train). Les choses s’accélèrent et le peuple français est toujours sidéré, prêt à se faire tirer comme des lapins, juste bons à fuir. Il existe une petite colère, désordonnée, qui ne sait pas sur qui se porter. Les musulmans, les gouvernants, les deux, ils ne savent pas. C’est une petite colère minable qui ne débouchera sur rien. Ils vont cracher sur le lieu où le terroriste est mort. C’est aussi utile que de sortir le stylo levé après le 13 Novembre.
Personnellement je n’ai pas de colère, pas même un agacement; constat lucide : nous savions et nous n’avons rien fait. Je me dis aussi la Corse sera touchée un jour ou l’autre et je dois m’y préparer. Surtout, le jour où cela arrivera, les lendemains seront terribles.
(...)
20 Août
J’ai passé deux semaines au village. Jamais il ne m’avait semblé si calme, si accueillant et bienveillant. J’aime cet endroit comme s’il était le plus beau de tous, comme s’il était à part. Vanina dit : regarde l’espace qu’on a ici, il n’y a personne, ce qui rend fou à Paris c’est d’être toujours collés les uns aux autres. Elle a raison. Elle envie beaucoup mon retour.
J’ai aussi fait quelques bals de « la semaine noire ». Au comptoir, à boire, à rire. Mais il faut dire qu’aucun n’était aussi bien que le nôtre et ce, sans chauvinisme aucun. Également revu Esteban que je n’avais plus croisé depuis cinq ou six ans. C’est devenu un petit homme mais il s’est étonnement francisé. Avec son pantalon taupe, son t-shirt blanc et sa veste sur les épaules (oui, sur les épaules ! et non en bandoulière comme il l’aurait porté avant) il ressemble à ce qu’il est : un étudiant en école de commerce en phase d’aller passer un an en Chine avant de mener sa vie ailleurs qu’en Corse. Quand nous étions au collège lui était carrément parti vivre au village et je trouvais sa décision folle. Plus folle que d’aller en Chine. Aujourd’hui c’est tout l’inverse.
Vu P. B. dont on m’avait beaucoup parlé et sur lequel je m’étais fait mille films.
Plutôt petit, trapu. Il a une voix grave et menaçante. L’air peu aimable et l'oeil pas spécialement vif, le regard assez morne. L. dit que c’est « quand on ne le connait pas ». L’art d’avoir l’air con seulement avec les étrangers me semble particulièrement enviable mais je doute que cela soit de ça dont il s’agit. Enfin je ne peux pas lui dénier une certaine force d’attraction purement physique, Anna dit « c’est la testotéronne, c’est toujours la testostérone de toutes façons, pour toutes les filles c’est ça ». Je le recroiserai sans doute dans l’année j’en dirai plus. Pour le moment je pense que c’est un imbécile malpoli.
Déjeuné à P. avec toute la famille de Nathalie. Je commence enfin à me détendre, à oser parler. Je me suis rendue compte de ça le soir des bals aussi. Je n’ose pas parler aux inconnus. Quelque chose en moi se bloque et je n’ai rien à leur dire. Il faut absolument que je surpasse cela pour la rentrée ou ce sera une catastrophe. Ensuite nous sommes montés à la madone et je me suis agenouillée pour dire une dizaine mais des gens sont arrivés et je n’ai pas osé la dire en entier. Je me hais quand je suis tiède. Vraiment.
Aujourd’hui rencontré un journaliste qui veut écrire un papier sur nous dans un journal national. Je ne le sens pas mais F. sans nous consulter, nous avait déjà engagés. Quand il fait ça, quand il n’écoute que lui, je voudrais le frapper. Nous avons refusés que nos noms et nos visages apparaissent. Le journaliste dit « oui et j’aimerai ensuite faire un documentaire télé, Fr2 blablabla », nous l’avons immédiatement arrêté et je me demandais mais enfin il n’aura trouvé que nous, qui, et je ne déplore, ne représentons personne ? Je crains le pire avec ce papier. Je ne peux m’empêcher de penser au bon mot d’A. S. sur les journalistes qui sont soient des putes soit des chômeurs.
L’ère qui s’ouvre n’en est que plus prometteuse : tout reste à faire.
Papa et maman veulent m’acheter un appartement. Quelque chose me gêne dans une telle aisance financière, dans leurs efforts pour me mettre à l’abris du moindre danger, pour me « constituer un patrimoine ». L’expression est si laide. Je sens trop qu’un jour leur bonté m’étouffera. Le moment venu ces facilités m’empêcheront de prendre les bonnes décisions, de faire des choix radicaux mais nécessaires. Je refuse toutefois d’avoir honte de ma qualité de bourgeoise et même de la renier — tout reniement est une impasse. Pourtant je vois l’étau du confort se resserrer et une part de moi s’alarme. Donc je freine l’entreprise, je dis : réfléchissez bien, pas trop cher, pas trop grand, ne me faites pas encore culpabiliser de vous couter si cher etc. Ils répondent « tu es notre seule enfant » et un poids colossal s’abat sur mes épaules.
6 Juin. Mes derniers jours à Paris sont résolument mornes. Le temps est désormais étrange. Même lorsque la lumière du soleil perce le ciel reste couvert, l’air est lourd et quelque chose m’empêche de respirer normalement.
Je sens trop que rien ne me manquera; ou du moins jamais de la façon dont la Corse m’a manquée pendant ces dernières années — c’est à dire cruelle, vitale.
La Corse n’entretient pas les illusions. Si vous y êtes malheureux c’est impossible de croire qu’un évènement merveilleux va soudainement venir bouleverser votre vie, briser malgré vous la routine dans laquelle vous vous êtes installés. Vos possibilités dans toute leur étendue sont là, face à vous, vous les connaissez toutes et rien ne peut plus venir vous surprendre. À Paris au contraire on a toujours l’impression d’être au bord de quelque chose, d’un changement capital… qui n’arrive jamais ici non plus, mais l’espoir demeure tenace et est entretenu par les gesticulations constantes des autres autour de nous. En Corse chaque chose est à sa place et vous aussi.
Il me faudra donc donner le ton dès le début. J’essaie de me mettre dans un bon état d’esprit, moins coincé et plus combatif que d’habitude. Je repense à toutes les fois où j’ai été jeté dans un environnement nouveau (en l’occurence celui-ci le sera aussi parce qu’entre 18 et 22 ans les cartes sont rebattues, les équipes reconstituées, le paysage social chamboulé), au temps que je perds à croire que je ne mérite pas les gens que j’apprécie alors qu’ils finissent généralement par venir vers moi. Au CS une fille qui s’appelait Sarah et avec qui j’aurais dû rester dès le début m’avait dit que leur bande se demandait pourquoi j’avais si longtemps trainé avec les débiles à mon arrivée au centre. Je n’avais pas oser lui répondre que c’était par peur qu’eux ne veuillent pas de moi. Je garde cet échange en tête.
Je n’arrête pas de penser à la discussion d’Alcibiade et Socrate à propos de l’accord des gens qui composent la citée, sur quoi doit-il tenir ? Aucun savoir en particulier. Donc sur quoi est-on d’accord ? D’où naît la philein qui unit les citoyens ? Peut-il y avoir philein sans accord ? Comment ? Je suis restée bloquée sur ce passage. À partir de lui et des conceptions française et allemande de la nation on peut réfléchir à la situation de l’Europe actuellement — et à la saison 6 de The Walking Dead. Il faudrait que je prenne sérieusement le temps d’écrire tout ça.
14 JuinJe suis rentrée en Corse. Nous avons trouvé l’appartement et je ne m’en plains plus. Il me servira. Il est situé dans une rue merveilleuse du vieux Bastia, une rue préservée de tout comme on n’oserait même plus en rêver ailleurs. Une rue comme celle dans les premiers Nanni Moretti.
D’ailleurs maman est partie cette semaine pour Rome faire son documentaire sur la liturgie, je me retrouve donc seule à la maison. Tout est très tranquille. Je lis jusqu’en fin d’après-midi puis je pars voir mamie. Toujours un peu peur de la trouver trop affaiblie, de revivre le cauchemar de l’été dernier. Je sens qu’elle n’a plus envie de vivre. Chose plus étrange encore j’ai progressivement vu cette volonté la quitter. Il n’y a pas si longtemps Nana et elle s’étreignaient avec force, et Nana ne cessait de répéter « on est toujours là Hortense ! On est toujours là ! ti rendi conti ?! ». Mais aujourd’hui je sens que ma grand-mère se rêve déjà ailleurs.
Mariage d’Émilie et Paul, il y a deux jours. Je l’attendais comme le premier vrai évènement de l’été.
Je me sentais étrangement loin de tout, mal à l’aise dans cette famille qui m’est devenue proche si vite mais que je connais encore si mal.
Le soir lors de la réception un groupe jouait des chansons très à gauche — comme Bella Ciao, Commandante Che Guevara, ou même du Tryo. Je me demandais ce qu’ils pouvaient bien ressentir avec un tel répertoire devant des femmes portant des sacs Chanels et des carrés Hermès qui mangeaient des petites vérines sans leur prêter la moindre attention, sinon pour dire à leur voisine « la musique est un peu forte, non ? ».
Je regardais tout de loin. Je n’avais rien à dire. Il me semble d’ailleurs qu’en leur compagnie je perds toujours toute répartie. Jamais rien d’intéressant ni de drôle ne sort de ma bouche. Ils doivent penser que mon père est fou de dire tant de bien de moi.
Enfin la composition de notre table était tout de même savoureuse. Mettre un ancien de la BAC à coté d’un ex du grand banditisme international, le premier ignorant tout du passé du second… Génie.
J’ai aussi été témoin d’une scène intéressante, qui m’a rappelé quelque chose que j’oublie souvent : la bêtise est parfois généreuse. Il y avait la fille de G. J’ai vite compris que ce n’était pas une flèche. Je ne dis pas que c’est une demeurée mais elle a sans doute été élevée, par sa mère, dans des conditions telles qu’elle n’a pas pu se développer pleinement. Le fait est : les enfants avaient préparé — avec la femme qui s’occupait d’eux pendant la réception — une petite chorégraphie, et, au moment de l’effectuer, tous les adultes, parents mis à part, les regardaient las et pressés de pouvoir continuer leur discussion et leur repas. Mais la fille de G. était debout et les applaudissait, les encourageait. Je sentais que c’était un élan de générosité pure qui n’était dû qu’à sa simplicité et qui nous renvoyait tous autant que nous étions à notre sécheresse. Nous ne nous soucions pas le moins du monde du plaisir de ces enfants. Nous pensions « ils ont l’air cons à gesticuler comme ça » ou « mais à quoi ça sert ? » en ayant hâte que tout ce cirque prenne fin.
Finalement je suis rentrée très tôt avec le sentiment d’avoir quelque part manqué à mon devoir. J’aurais voulu faire meilleure impression, être plus souriante et sympathique, tandis que je n’avais été qu’égale à moi-même, c’est-à-dire renfermée et taciturne.
9 Juillet Je n’ai plus écrit depuis presque un mois et pourtant bien des choses se sont passées quoique je n’en garde presque aucun souvenir.
Je suis retournée à Paris vider mon appartement. C’était pénible mais je pensais : après ça tout sera vraiment terminé. Envie de couper les ponts avec cette ville et la France en général. Ne plus regarder ce qui s’y passe, ne plus me sentir concernée par elle: conquérir une autonomie mentale. J’avais prévu de revoir beaucoup de monde mais finalement je n’ai fait qu’un déjeuner avec Sarah (qui part au Québec l’an prochain) et Regina (qui reste à Paris et viendra vite me voir, j’espère). J’y ai appris des choses croustillantes sur Monsieur S., notamment qu’il avait eu une relation un peu trouble avec Marie avant de prendre peur et de lui demander de garder ses distances. Évidement il ne s’est rien passé entre eux mais… contrairement à ce que disait Sarah je ne pense pas que Marie soit la seule responsable de cette ambiguïté. S est tellement sensible au regard que les élèves portent sur lui, qu’il s’est sans doute laissé grisé par l’admiration de Marie.
Il a toujours fait une forte impression sur moi aussi, mais je n’ai jamais trop voulu m’en approcher. Pour me toucher les profs doivent rester loin, c’est une règle intangible.
Après quoi je suis rentrée et nous avons enterré Yolande. Enterrement étrange, personne ne pleurait trop, et surtout deux de ses petits enfants (qui incarnent d’une manière providentielle tout ce que mes cousins détestent : « gros français », écolos, végans, féministes, « sales », de gauche, etc.) ont parlé. Pour bien faire il faudrait mettre un point d’exclamation : ont parlé ! tellement la chose semble inconcevable. Mais il parait qu’en France cela se fait, les gens viennent parler de ceux qu’ils ont perdu et pleurer devant l’assemblée. Ma foi. La démarche me semblait mal venue pourtant je dois reconnaitre que dans la froideur ambiante elle a mis un peu d’humanité.
Le même jour une crise d’hystérie a secoué ma famille parce que Maman voulait envoyer mamie à l’hôpital et les autres trouvaient que c’était exagéré, qu’il fallait arrêter de l’envoyer aux urgences pour un oui ou pour un non, qu’elle était vieille et voilà tout. Moi j’étais très affectée alors j’essayais de résonner maman d’un coté en communicant discrètement avec le reste de la famille de l’autre et je voyais ma mère se décomposer à mesure que nous nous rapprochions de Bastia. Dans la voiture mon père prenait mystérieusement la défense de mère, ce qui m’était plus insupportable que tout, et il ne me restait que quelques heures pour envoyer mon dossier d’inscription à la fac. La tension devenait insoutenable.
Puis des jours ont passé sans que rien de notable ne surviennent, puis Fred et moi sommes montés voir la petite Isabelle à San Martinu. A. s’est montrée très honnête sur la maternité alors que ses opinions auraient pu la pousser à dire tout l’inverse.
Je suis d’ailleurs excédée par tous ces articles sortis récemment qui disent qu’être mère est une plaie parce qu’on sent trop le message sous-jacent : cet enfant est une entrave à mon épanouissement qui ne trouve sa raison d’être que dans mon égoïsme. J’avais lu un article sur des femmes qui allaient jusqu’à exprimer sur facebook, dans un groupe dédié, leur regret d’être mère. A. disait s’être rendue compte de manière très abrupte de la difficulté de s’occuper soudainement d’un être qui dépend entièrement de vous quand on ne s’est, pendant toute sa vie d’adulte, jamais soucié que de soi et de son couple. Et c’est vrai qu’il ne faut rien idéaliser. Mais regretter d’avoir des enfants, aller jusque là, pour moi, relève de la maladie mentale. Pour A : je pense qu’une fois la période de transition passée tout rentrera dans l’ordre.
Ensuite Fred et moi sommes partis à Florence, un jour seulement, pour voir une messe d’ordination célébrée par le cardinal Burke. Les prêtres étaient issus de l’Institut Christ Roi et je pense qu’au moins cinq des onze ordonnés étaient français donc dans l’Eglise tout le monde ou presque l’était également. (Il y avait même JMLP !)
La cérémonie a duré quatre heures. Les chants étaient magnifiques et l’entrée du Cardinal avec sa capa magna en imposait mais je dois dire que je n’ai pas particulièrement été touchée. Tout m’avait l’air un peu trop baroque, un peu trop grandiose. Évidement l’occasion commandait cette débauche de moyens mais elle me laissait insensible. Et puis il faut dire ce qui est, quatre heures, comme ça, dans une chaleur infernale, c’est très long. À un moment j’ai fini par être obnubilée par mon inconfort, je n’arrivais plus à penser à rien d’autre et de fait la grâce ne pouvait plus opérer.
Par la suite nous sommes allés manger puis nous nous sommes un peu promené avant de reprendre le train. Il faisait 36*, j’avais des ampoules sous les pieds.
(...)
Note sur Livourne : une chose très rassurante dans cette ville qui a pourtant l’air damnée, les gens semblent très peu préoccupés par leur emploi mais tout disposés à vivre. On dirait qu’ils n’occupent aucun poste, leur moyen de gagner des sous parait être un aléa plus ou moins heureux qu’ils accomplissent souvent de mauvaise grâce, ou avec beaucoup de distance. L’air de dire je suis là parce qu’il le faut mais bon ma vie est ailleurs. J’aime cette indolence. En France on a toujours l’impression inverse, les gens mettent tout ce qu’ils ont dans leur métier, c’est ce qui les résume entièrement.
18 Juillet
Attentat de Nice il y a quatre jours, un autre petit en allemagne ce soir (une attaque à la hache dans un train). Les choses s’accélèrent et le peuple français est toujours sidéré, prêt à se faire tirer comme des lapins, juste bons à fuir. Il existe une petite colère, désordonnée, qui ne sait pas sur qui se porter. Les musulmans, les gouvernants, les deux, ils ne savent pas. C’est une petite colère minable qui ne débouchera sur rien. Ils vont cracher sur le lieu où le terroriste est mort. C’est aussi utile que de sortir le stylo levé après le 13 Novembre.
Personnellement je n’ai pas de colère, pas même un agacement; constat lucide : nous savions et nous n’avons rien fait. Je me dis aussi la Corse sera touchée un jour ou l’autre et je dois m’y préparer. Surtout, le jour où cela arrivera, les lendemains seront terribles.
(...)
20 Août
J’ai passé deux semaines au village. Jamais il ne m’avait semblé si calme, si accueillant et bienveillant. J’aime cet endroit comme s’il était le plus beau de tous, comme s’il était à part. Vanina dit : regarde l’espace qu’on a ici, il n’y a personne, ce qui rend fou à Paris c’est d’être toujours collés les uns aux autres. Elle a raison. Elle envie beaucoup mon retour.
J’ai aussi fait quelques bals de « la semaine noire ». Au comptoir, à boire, à rire. Mais il faut dire qu’aucun n’était aussi bien que le nôtre et ce, sans chauvinisme aucun. Également revu Esteban que je n’avais plus croisé depuis cinq ou six ans. C’est devenu un petit homme mais il s’est étonnement francisé. Avec son pantalon taupe, son t-shirt blanc et sa veste sur les épaules (oui, sur les épaules ! et non en bandoulière comme il l’aurait porté avant) il ressemble à ce qu’il est : un étudiant en école de commerce en phase d’aller passer un an en Chine avant de mener sa vie ailleurs qu’en Corse. Quand nous étions au collège lui était carrément parti vivre au village et je trouvais sa décision folle. Plus folle que d’aller en Chine. Aujourd’hui c’est tout l’inverse.
Vu P. B. dont on m’avait beaucoup parlé et sur lequel je m’étais fait mille films.
Plutôt petit, trapu. Il a une voix grave et menaçante. L’air peu aimable et l'oeil pas spécialement vif, le regard assez morne. L. dit que c’est « quand on ne le connait pas ». L’art d’avoir l’air con seulement avec les étrangers me semble particulièrement enviable mais je doute que cela soit de ça dont il s’agit. Enfin je ne peux pas lui dénier une certaine force d’attraction purement physique, Anna dit « c’est la testotéronne, c’est toujours la testostérone de toutes façons, pour toutes les filles c’est ça ». Je le recroiserai sans doute dans l’année j’en dirai plus. Pour le moment je pense que c’est un imbécile malpoli.
Déjeuné à P. avec toute la famille de Nathalie. Je commence enfin à me détendre, à oser parler. Je me suis rendue compte de ça le soir des bals aussi. Je n’ose pas parler aux inconnus. Quelque chose en moi se bloque et je n’ai rien à leur dire. Il faut absolument que je surpasse cela pour la rentrée ou ce sera une catastrophe. Ensuite nous sommes montés à la madone et je me suis agenouillée pour dire une dizaine mais des gens sont arrivés et je n’ai pas osé la dire en entier. Je me hais quand je suis tiède. Vraiment.
Aujourd’hui rencontré un journaliste qui veut écrire un papier sur nous dans un journal national. Je ne le sens pas mais F. sans nous consulter, nous avait déjà engagés. Quand il fait ça, quand il n’écoute que lui, je voudrais le frapper. Nous avons refusés que nos noms et nos visages apparaissent. Le journaliste dit « oui et j’aimerai ensuite faire un documentaire télé, Fr2 blablabla », nous l’avons immédiatement arrêté et je me demandais mais enfin il n’aura trouvé que nous, qui, et je ne déplore, ne représentons personne ? Je crains le pire avec ce papier. Je ne peux m’empêcher de penser au bon mot d’A. S. sur les journalistes qui sont soient des putes soit des chômeurs.
lundi 16 mai 2016
13 Mars 2016 Si je n’arrive plus à écrire, à tenir de journal ni à sentir quand mes phrases se tiennent, visent juste, décrivent au plus près ce que je ressens c’est en partie, je crois, parce que depuis le début, depuis que je suis pour la première fois allée la voir à l’hôpital, j’ai refusé d’aborder franchement le seul sujet qui méritait de l’être : Suzanne.
Aucun mot ne semble assez fort pour circonscrire ma douleur, elle est à la fois trop grande et trop profonde pour se laisser saisir. Je n’avais plus ressenti un tel déchirement depuis la séparation de mes parents, quelque chose de si radical qu’il nous laisse idiot devant le fait accompli, irrévocable.
Du jour où je suis pour la première fois allée la voir à l’hôpital, à Oletta, j’ai su qu’il ne me restait plus qu’à attendre sa mort, à la regarder m’oublier puis mourir. Je la revois sur ce lit, un lit si bas, collé contre le mur de cette petite chambre d’hôpital que je jugeais indigne d’elle, et sa voix avait changé, ses intonations n’étaient déjà plus les mêmes et je ne savais pas si elle délirait momentanément ou si désormais elle ne serait plus que comme ça. Ce jour là je l’avais déjà perdue et j’en avais conscience.
Elle avait mal, je voyais sa souffrance et je me souvenais de cette nuit où, chez mon père, je l’entendais tousser de ma chambre et j’avais peur qu’elle meurt, tellement peur qu’après être allée m’assurer que tout allait bien j’en avais pleurer toute la nuit; cette nuit là était un avant-goût, un pressentiment de tout ce que je vis aujourd’hui.
Mon été tout entier était le prolongement même de cette nuit, une perpétuelle angoisse de la perdre et pourtant la connaissance du caractère aussi proche qu’inéluctable de sa disparition. Elle allait mourir et je ne pouvais que lui prendre la main et me retenir au mieux de pleurer en sa présence. Je me souviens d’un jour où, allant la voir dans la salle commune de sa nouvelle maison de retraite, j’avais détourné d’elle mon regard pour qu’elle ne voit pas mes larmes et j’avais croisé le regard bienveillant d’une autre patiente, en bien meilleure santé qu’elle, qui semblait compatir à ma douleur. Elle me souriait discrètement et j’ai pensé qu'elle avait peut-être pu sentir tout l’amour que j’avais pour Suzanne, voir la pureté et la beauté de notre amour.
Depuis sa mort je me repasse sans cesse ces scènes et toutes les autres, celles de mon enfance et les derniers moments passés avec elle dans la maison du village.
Elle n’est plus nulle part dans le monde. La radicalité de cette pensée me donne le vertige. Elle n’est pas juste loin de moi, elle n’est plus là. Je sais qu’elle est au ciel et je devrais être apaisée à l’idée qu’elle puisse, de là-haut, veiller sur moi, mais je suis juste anéantie à l’idée de ne plus la savoir à portée de main. Je voudrais l’embrasser et l’entendre. À l’enterrement avant que l’on ne referme le cercueil j’ai refusé d’aller lui faire un dernier bisou. Je m’en veux terriblement aujourd’hui. Ce n’était que son corps mais c’est précisément lui qui aujourd’hui me manque tant. Je crois en Dieu, à la vie après la mort, pourtant aujourd’hui c’est sa présence physique que je voudrais retrouver.
Dans 13 jours j’aurais 22 ans, ce sera mon premier anniversaire sans elle, la première année de ma vie sans la femme qui m’a tout offert. Un jour je me suis demandée si j’avais reçu d’elle un héritage immatériel, comme on dirait qu’on hérite des traits de son père et du caractère de sa mère. La réponse est oui. J’ai tout reçu d’elle. Ce que je mets parfois abusivement sur le compte de la génétique vient en fait d’elle et plus assurément encore si j’ai un jour eu une once de confiance en moi c’est d’abord grâce à sa tendresse et l’attention qu’elle m’a toujours donnée.
Il n’y aurait pas assez d’une vie pour dire à quel point je l’aimais et ces mots seraient de toutes façons superflus. Nous n’avions besoin que d’un regard pour nous exprimer l’amour que nous éprouvions l’une pour l’autre et je sens que tout ça mérite de rester dans l’intimité de notre relation, secret.
Aujourd’hui quelque chose en moi me dit qu’elle ne voudrait pas que je sois si malheureuse. Et je veux rester fidèle à mon amour pour elle, pas à ma douleur.
14 Mars
Retrouver cette citation sur un billet de mon blog datant du Jeudi 9 Août 2012 :
"Bien sûr, les choses tournent mal, pourtant, tu serais parti et, quand l’étreinte du monde serait devenue trop puissante, tu serais rentré chez toi. Mais ça ne s’est pas passé comme ça, car les choses tournent mal à leur manière mystérieuse et cruelle de choses et font se briser contre elles toutes les illusions de lucidité. Tu es parti, le monde ne t’a pas étreint et, quand tu es rentré, il n’y avait plus de chez toi." Un Dieu un Animal, Jérôme Ferrari.
«Le monde ne t’a pas étreint » cette formule est idéale pour résumer ces quatre années parisiennes. À vrai dire je ne sais pas si le monde ne m’a pas étreint ou si j’ai refusé de me laisser prendre mais lui et moi nous sommes manifestement manqués.
Dans la suite du billet je dis que c’est l’orgueil que nous tirons de nos origines qui nous poussera, le moment venu, à rentrer. Aujourd’hui je sais que c’est l’inverse : l’orgueil nous aide à partir, nous donne la force de quitter l’île mais c’est une certaine forme d’humilité qui nous amène à comprendre que nous ne sommes que de là et que l’on se doit, modestement, d’y retourner prendre notre place.
15 Mars Samedi je suis passée à la galerie avec Priya. Je lui ai dit « on se sent bien ici non ? » et elle m’a répondu « bien sûr que tu te sens bien, toi au milieu de tes pairs ». Il n’y avait pas d’agressivité dans sa voix, ce n’était pas un reproche, mais j’étais surprise par sa remarque, un peu vexée même.
Depuis que je fréquente la bande de N. je ne les ai jamais identifiés comme étant mes pairs et d’ailleurs je pense qu’il en va de même pour eux à mon égard. Ils sont tous tellement parisiens — à part N. et éventuellement A. — qu’aucun d’entre eux ne survivrait plus de dix minutes en milieu rural. C’est à mon sens suffisant pour les discréditer. Au fond je leur trouve un raffinement dont je suis dépourvue, mais un raffinement qui n’aurait rien d’une pure élégance, qui serait au contraire plutôt comme suranné et gauche : un raffinement de fin de race.
Je n’éprouve aucun respect pour les frères V. ou pour V., ils me dégoutent même un peu. C’est surtout comme s’il n’y avait rien à dire sur eux, comme si leur existence était si faible, leur présence au monde si insignifiante que mon regard, à moins que je ne le stoppe volontairement, que je ne lui ordonne d’y faire attention, pourrait passer et repasser sur eux sans jamais les voir, sans jamais rien leur trouver de remarquable, au sens propre du terme. Ils sont l’inverse absolu de M-E N, ses parfaits négatifs, ce qui lui donne d’autant plus d’éclat.
20 Mars
La date anniversaire de ma conversion approche.
J’ai du mal à évaluer le chemin parcouru depuis un an, à cerner celle que je suis devenue maintenant que je crois en Dieu et pratique ma foi.
Je pense que j’ai toujours creusé mon identité dans un unique sillon, sans jamais dévié et que la semaine pascale 2015 a été le point d’orgue d’un long cheminement où ce que j’avais toujours cherché s’est enfin dévoilé, me donnant la force d’assumer pleinement le choix de mes orientations les plus intimes et d’être en phase avec moi-même. C’est un accomplissement qui ne saurait connaître aucune dénégation, comme si j’avais jusqu’alors avancé à l’aveugle et que je voyais désormais l’ultime fin, le bout du tunnel, auquel je ne pouvais plus tourner le dos.
Quand je vais à Saint Nicolas je trouve ceux qui ont hérité de ce que j’ai dû découvrir par mes propres moyens très beaux. Quelque chose dans l’élancement de leur physionomie, la grâce de leurs gestes ou la pureté de leurs traits nous laisse deviner à quel point ils ont été protégé d’une certaine laideur contemporaine, mis à l’abris par une solide éducation inspirée de saines valeurs. J’envie parfois leur assurance, celle donnée par la certitude d’être d’un milieu sécurisant et de ne jamais vouloir en sortir. Ils représentent quelque chose de noble et d’intemporel.
Ce matin nous célébrions les Rameaux et près de 600 personnes sont entrés dans l’église après une courte procession depuis la place Maubert; tandis que nous marchions dans la rue en chantant le Gloria les gens nous regardaient toujours étonnés, parfois émus, comme s’ils redécouvraient soudainement ce qu’avait été leur pays et qu’une petite frange de la population continuait par miracle d’incarner, dans l’ombre. Notre ferveur était palpable et aucun de ceux que nous croisions ne s’y trompait. J’étais heureuse d’en être, d’avoir fait l’effort de me lever et de descendre alors que ma paresse avait bien failli m’en empêcher. Il n’y a pas que ça. Parfois le dimanche matin ce n’est pas l’envie de dormir mais une sorte de honte, celle de n’être pas encore assez bonne catholique qui, paradoxalement, me retient d’aller à la messe. Parfois je cède. Pourtant quand je me force je suis toujours récompensée et aujourd’hui, en plus d’avoir assisté à une messe somptueuse, j’ai passé une excellente après midi, très enrichissante, en compagnie de J. et deux amis à lui — dont je parlerais peut-être plus longuement une prochaine fois — ce qui, évidemment, n’aurait jamais été le cas si je m’étais recouchée.
21 Mars
Comme L. était de passage à Paris nous avons passé la journée ensemble. J’aime la façon dont il se comporte avec moi, il est le seul à se montrer tactile, protecteur, à ne pas me réduire à mon intelligence ou ma culture, à voir en moi quelque chose comme une enfant quand tout le monde salue — et de tout temps — ma remarquable maturité. Avec lui je me sens le droit d’être légère et idiote sans risquer d’être méprisée.
Dommage qu’il puisse par ailleurs se montrer si peu capable d’auto-discipline, souvent capricieux et ingérable. Mais je ne supporte pas pour autant la manière dont F. et les autres parlent parfois de lui, comme s’il était perdu. Je prendrai toujours sa défense.
26 Mars
J’ai laissé beaucoup de mes amis s’éloigner sans permettre à d’autres de s’approcher; je me retrouve donc aujourd’hui avec une constellation de gens qui ne s’avanceront jamais au-delà d’un certain point, d’un certain degré d’intimité. Je suis seule et prise au piège. Je voudrais être de nouveau entourée, protégée, choyée par ceux qui vous aiment en l’absence de tout lien du sang, de toute obligation héréditaire : gratuitement.
Je ne me sens même plus négligée par les autres mais carrément négligeable. L’impression que le monde pourrait me balayer d’un revers de main sans que cela ne s’en ressente.
Aucun mot ne semble assez fort pour circonscrire ma douleur, elle est à la fois trop grande et trop profonde pour se laisser saisir. Je n’avais plus ressenti un tel déchirement depuis la séparation de mes parents, quelque chose de si radical qu’il nous laisse idiot devant le fait accompli, irrévocable.
Du jour où je suis pour la première fois allée la voir à l’hôpital, à Oletta, j’ai su qu’il ne me restait plus qu’à attendre sa mort, à la regarder m’oublier puis mourir. Je la revois sur ce lit, un lit si bas, collé contre le mur de cette petite chambre d’hôpital que je jugeais indigne d’elle, et sa voix avait changé, ses intonations n’étaient déjà plus les mêmes et je ne savais pas si elle délirait momentanément ou si désormais elle ne serait plus que comme ça. Ce jour là je l’avais déjà perdue et j’en avais conscience.
Elle avait mal, je voyais sa souffrance et je me souvenais de cette nuit où, chez mon père, je l’entendais tousser de ma chambre et j’avais peur qu’elle meurt, tellement peur qu’après être allée m’assurer que tout allait bien j’en avais pleurer toute la nuit; cette nuit là était un avant-goût, un pressentiment de tout ce que je vis aujourd’hui.
Mon été tout entier était le prolongement même de cette nuit, une perpétuelle angoisse de la perdre et pourtant la connaissance du caractère aussi proche qu’inéluctable de sa disparition. Elle allait mourir et je ne pouvais que lui prendre la main et me retenir au mieux de pleurer en sa présence. Je me souviens d’un jour où, allant la voir dans la salle commune de sa nouvelle maison de retraite, j’avais détourné d’elle mon regard pour qu’elle ne voit pas mes larmes et j’avais croisé le regard bienveillant d’une autre patiente, en bien meilleure santé qu’elle, qui semblait compatir à ma douleur. Elle me souriait discrètement et j’ai pensé qu'elle avait peut-être pu sentir tout l’amour que j’avais pour Suzanne, voir la pureté et la beauté de notre amour.
Depuis sa mort je me repasse sans cesse ces scènes et toutes les autres, celles de mon enfance et les derniers moments passés avec elle dans la maison du village.
Elle n’est plus nulle part dans le monde. La radicalité de cette pensée me donne le vertige. Elle n’est pas juste loin de moi, elle n’est plus là. Je sais qu’elle est au ciel et je devrais être apaisée à l’idée qu’elle puisse, de là-haut, veiller sur moi, mais je suis juste anéantie à l’idée de ne plus la savoir à portée de main. Je voudrais l’embrasser et l’entendre. À l’enterrement avant que l’on ne referme le cercueil j’ai refusé d’aller lui faire un dernier bisou. Je m’en veux terriblement aujourd’hui. Ce n’était que son corps mais c’est précisément lui qui aujourd’hui me manque tant. Je crois en Dieu, à la vie après la mort, pourtant aujourd’hui c’est sa présence physique que je voudrais retrouver.
Dans 13 jours j’aurais 22 ans, ce sera mon premier anniversaire sans elle, la première année de ma vie sans la femme qui m’a tout offert. Un jour je me suis demandée si j’avais reçu d’elle un héritage immatériel, comme on dirait qu’on hérite des traits de son père et du caractère de sa mère. La réponse est oui. J’ai tout reçu d’elle. Ce que je mets parfois abusivement sur le compte de la génétique vient en fait d’elle et plus assurément encore si j’ai un jour eu une once de confiance en moi c’est d’abord grâce à sa tendresse et l’attention qu’elle m’a toujours donnée.
Il n’y aurait pas assez d’une vie pour dire à quel point je l’aimais et ces mots seraient de toutes façons superflus. Nous n’avions besoin que d’un regard pour nous exprimer l’amour que nous éprouvions l’une pour l’autre et je sens que tout ça mérite de rester dans l’intimité de notre relation, secret.
Aujourd’hui quelque chose en moi me dit qu’elle ne voudrait pas que je sois si malheureuse. Et je veux rester fidèle à mon amour pour elle, pas à ma douleur.
14 Mars
Retrouver cette citation sur un billet de mon blog datant du Jeudi 9 Août 2012 :
"Bien sûr, les choses tournent mal, pourtant, tu serais parti et, quand l’étreinte du monde serait devenue trop puissante, tu serais rentré chez toi. Mais ça ne s’est pas passé comme ça, car les choses tournent mal à leur manière mystérieuse et cruelle de choses et font se briser contre elles toutes les illusions de lucidité. Tu es parti, le monde ne t’a pas étreint et, quand tu es rentré, il n’y avait plus de chez toi." Un Dieu un Animal, Jérôme Ferrari.
«Le monde ne t’a pas étreint » cette formule est idéale pour résumer ces quatre années parisiennes. À vrai dire je ne sais pas si le monde ne m’a pas étreint ou si j’ai refusé de me laisser prendre mais lui et moi nous sommes manifestement manqués.
Dans la suite du billet je dis que c’est l’orgueil que nous tirons de nos origines qui nous poussera, le moment venu, à rentrer. Aujourd’hui je sais que c’est l’inverse : l’orgueil nous aide à partir, nous donne la force de quitter l’île mais c’est une certaine forme d’humilité qui nous amène à comprendre que nous ne sommes que de là et que l’on se doit, modestement, d’y retourner prendre notre place.
15 Mars Samedi je suis passée à la galerie avec Priya. Je lui ai dit « on se sent bien ici non ? » et elle m’a répondu « bien sûr que tu te sens bien, toi au milieu de tes pairs ». Il n’y avait pas d’agressivité dans sa voix, ce n’était pas un reproche, mais j’étais surprise par sa remarque, un peu vexée même.
Depuis que je fréquente la bande de N. je ne les ai jamais identifiés comme étant mes pairs et d’ailleurs je pense qu’il en va de même pour eux à mon égard. Ils sont tous tellement parisiens — à part N. et éventuellement A. — qu’aucun d’entre eux ne survivrait plus de dix minutes en milieu rural. C’est à mon sens suffisant pour les discréditer. Au fond je leur trouve un raffinement dont je suis dépourvue, mais un raffinement qui n’aurait rien d’une pure élégance, qui serait au contraire plutôt comme suranné et gauche : un raffinement de fin de race.
Je n’éprouve aucun respect pour les frères V. ou pour V., ils me dégoutent même un peu. C’est surtout comme s’il n’y avait rien à dire sur eux, comme si leur existence était si faible, leur présence au monde si insignifiante que mon regard, à moins que je ne le stoppe volontairement, que je ne lui ordonne d’y faire attention, pourrait passer et repasser sur eux sans jamais les voir, sans jamais rien leur trouver de remarquable, au sens propre du terme. Ils sont l’inverse absolu de M-E N, ses parfaits négatifs, ce qui lui donne d’autant plus d’éclat.
20 Mars
La date anniversaire de ma conversion approche.
J’ai du mal à évaluer le chemin parcouru depuis un an, à cerner celle que je suis devenue maintenant que je crois en Dieu et pratique ma foi.
Je pense que j’ai toujours creusé mon identité dans un unique sillon, sans jamais dévié et que la semaine pascale 2015 a été le point d’orgue d’un long cheminement où ce que j’avais toujours cherché s’est enfin dévoilé, me donnant la force d’assumer pleinement le choix de mes orientations les plus intimes et d’être en phase avec moi-même. C’est un accomplissement qui ne saurait connaître aucune dénégation, comme si j’avais jusqu’alors avancé à l’aveugle et que je voyais désormais l’ultime fin, le bout du tunnel, auquel je ne pouvais plus tourner le dos.
Quand je vais à Saint Nicolas je trouve ceux qui ont hérité de ce que j’ai dû découvrir par mes propres moyens très beaux. Quelque chose dans l’élancement de leur physionomie, la grâce de leurs gestes ou la pureté de leurs traits nous laisse deviner à quel point ils ont été protégé d’une certaine laideur contemporaine, mis à l’abris par une solide éducation inspirée de saines valeurs. J’envie parfois leur assurance, celle donnée par la certitude d’être d’un milieu sécurisant et de ne jamais vouloir en sortir. Ils représentent quelque chose de noble et d’intemporel.
Ce matin nous célébrions les Rameaux et près de 600 personnes sont entrés dans l’église après une courte procession depuis la place Maubert; tandis que nous marchions dans la rue en chantant le Gloria les gens nous regardaient toujours étonnés, parfois émus, comme s’ils redécouvraient soudainement ce qu’avait été leur pays et qu’une petite frange de la population continuait par miracle d’incarner, dans l’ombre. Notre ferveur était palpable et aucun de ceux que nous croisions ne s’y trompait. J’étais heureuse d’en être, d’avoir fait l’effort de me lever et de descendre alors que ma paresse avait bien failli m’en empêcher. Il n’y a pas que ça. Parfois le dimanche matin ce n’est pas l’envie de dormir mais une sorte de honte, celle de n’être pas encore assez bonne catholique qui, paradoxalement, me retient d’aller à la messe. Parfois je cède. Pourtant quand je me force je suis toujours récompensée et aujourd’hui, en plus d’avoir assisté à une messe somptueuse, j’ai passé une excellente après midi, très enrichissante, en compagnie de J. et deux amis à lui — dont je parlerais peut-être plus longuement une prochaine fois — ce qui, évidemment, n’aurait jamais été le cas si je m’étais recouchée.
21 Mars
Comme L. était de passage à Paris nous avons passé la journée ensemble. J’aime la façon dont il se comporte avec moi, il est le seul à se montrer tactile, protecteur, à ne pas me réduire à mon intelligence ou ma culture, à voir en moi quelque chose comme une enfant quand tout le monde salue — et de tout temps — ma remarquable maturité. Avec lui je me sens le droit d’être légère et idiote sans risquer d’être méprisée.
Dommage qu’il puisse par ailleurs se montrer si peu capable d’auto-discipline, souvent capricieux et ingérable. Mais je ne supporte pas pour autant la manière dont F. et les autres parlent parfois de lui, comme s’il était perdu. Je prendrai toujours sa défense.
26 Mars
J’ai laissé beaucoup de mes amis s’éloigner sans permettre à d’autres de s’approcher; je me retrouve donc aujourd’hui avec une constellation de gens qui ne s’avanceront jamais au-delà d’un certain point, d’un certain degré d’intimité. Je suis seule et prise au piège. Je voudrais être de nouveau entourée, protégée, choyée par ceux qui vous aiment en l’absence de tout lien du sang, de toute obligation héréditaire : gratuitement.
Je ne me sens même plus négligée par les autres mais carrément négligeable. L’impression que le monde pourrait me balayer d’un revers de main sans que cela ne s’en ressente.
jeudi 8 octobre 2015
Journal II
5 Avril 2015
F. a, je crois, une emprise considérable sur les membres d’ICC et je sens son influence s’étendre lentement jusqu’à moi, d’une manière très trouble, disons même retorse. Je sais qu’elle atteint les autres de la même façon, de biais, avec une inflexible douceur. Il ne s’auto-désigne pas comme meneur mais il fait et on le suit, sans même s’en apercevoir.
7 Avril
Il faut que je comprenne bien une chose : dans ce journal, les faits n’ont aucune importance. À trop vouloir ne perdre aucun détail je délaisse mes meilleures intuitions. Tout se bouscule et je ne sais plus par où commencer. Je raconterai cette semaine pascale quand toutes mes pensées se seront misent en ordre.
8 Avril
« Quoi de plus beau qu'un homme grand et vigoureux, aux épaules larges et musclées, aux mâchoires dures, aux lèvres lourdes — et priant Dieu comme un enfant. »
Journal, Jean-René Huguenin.
10 Avril
(...)
Revenons-en à mon avenir. Doit-on toujours acter ses possibilités d’une indéniable et très tangible réussite scolaire ? Toutes nos capacités doivent-elles devenir rentables ? L’autre soir au Wha, quand je mangeais avec J., A. et F., l’un d’eux a mentionné la passion actuelle d’An. pour l’histoire, racontant que ce dernier l’avait doctement entretenu de Pline le Jeune et Pline l’Ancien, bien qu’ivre au dernier degré dans un bar des tréfonds du port de Toga. Voilà : des fois, je ne suis pas sûre de vouloir autre chose que de savantes discussions de comptoir.
Hier soir j’ai parlé de ces hésitations à F.. Je lui ai dit mon sentiment, celui d’être témoin d’un miracle permanent quand je rentrais : ici les gens ne se rendent plus compte de leur bonheur, tous vivent dans une félicité qui leur échappe parce que pour eux elle va de soi. Rien n’est moins naturel mais c’est tout juste si elle n’est pas devenu un dû. Je ne dis pas : les hivers peuvent être longs mais ils ne seront jamais aussi pénibles que ceux d’ailleurs, or c’est une chose que j’ignorais avant de partir.
Je commençais peut-être à m’en douter un peu les dernières années, je me souviens avoir eu des discussions à ce propos avec Ramatou quand nous remontions manger notre panini au lycée. L’air était pur et le ciel sans nuage, le froid glacial et nous étions heureuses. En Corse j’éprouve parfois une joie de vivre qui ne tient à rien d’autre qu’à ma présence physique sur cette île et je crois que c’est un sentiment partagé par beaucoup d’entre nous. D’ailleurs il y a un passage dans Le Principe de Ferrari qui me semble faire état de cette étrange élan du coeur mais je ne crois pas qu’il ait réussi à exploiter pleinement le potentiel incroyable de cette sensation aussi puissante que mystérieuse. À sa décharge, je reconnais volontiers qu’elle est très difficilement descriptible.
« Mon cousin semblait parfois ployer sous un poids énorme qui menaçait de le terrasser, et il lui fallait fuir, peut-être la canicule et l’incessante frénésie estivale, peut-être la migraine, le souvenir de nuits sordides ou quelque chose de plus sombre dont j’ignorais la nature. Il m’emmenait alors en montagne boire un café sur la terrasse d’un gîte d’étape, dans un ancien village de transhumance que traversait un sentier de randonnée. Nous y passions un moment, dans la fraîcheur des fougères, à l’ombre de grands pins. Mais son humeur restait maussade. Il ne m’adressait pas la parole. Nous reprenions sa voiture pour retourner en ville et soudain, sans que rien le laissât prévoir, au détour d’un virage, apparaissait la mer. Nous dominions le paysage, comme si nous étions suspendus dans l’air limpide, au-dessus de la route en lacets dévalant à pic à travers la forêt vers le golfe éblouissant qui s’étendait mille mètres en contrebas. Mon cousin ouvrait de grands yeux sur ce panorama qu’il connaissait depuis son enfance mais semblait découvrir à chaque fois comme si c’était la première. Il faisait une grimace incrédule, se mettait à sourire et me donnait des petits coups de poing sur la cuisse en disant, putain ! quand même, hein ? incapable d’exprimer avec davantage de clarté le sentiment qui le bouleversait et lui rendait aussi instantanément le goût de vivre, dans lequel il n’était pas difficile de reconnaître une curieuse forme d’amour qui aurait pris pour objet, non un autre être humain, mais une petite partie bien déterminée du vaste monde inerte, et dont, quoique je sois moi-même incapable de le ressentir, je devais cependant admettre l’incomparable puissance. »
Le principe, Jérôme Ferrari.
F., donc, me disait s’être pleinement rendu compte de ce bonheur diffus, inouï et constant; c’est justement ce qui l’avait décidé à ne jamais partir. Pour mon cas il ne s’est pas prononcé trop clairement, jugeant la situation complexe, mais m’a enjointe à ne pas prendre ma décision trop vite. On sait tous que les retours sont définitifs, j’en ai bien conscience. Cependant si continuer mes études à distance était possible… J’avoue avoir parler de mes doutes pour vérifier ce que l’évocation de mon éventuel retour suscitait chez lui. C’était idiot. Je ne pense pas lui plaire autrement que d’un point de vue strictement intellectuel, ce qui équivaut à ne pas plaire du tout à homme, j’en conviens, mais j’étais curieuse de voir sa réaction. J’éprouve pour ce type quelque chose d’assez inédit qui n’est pas une attirance franche, bestiale, à la façon dont un L. pourrait m’attirer (et, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, je reconnais que sa laideur m’attire peut-être plus que sa « beauté enfouie » dont je parlais la dernière fois). F. m’impressionne par la profondeur et l’intensité de sa vie spirituelle qui le coupe radicalement des autres. Il nous, ou disons il les entraine dans son sillage mais s’en retrouve, de fait, loin devant, seul. Je ne sais pas s’il s’est rendu compte qu’il les portait tous à bout de bras. Entendons nous bien, je ne remets pas en cause la croyance des membres d’ICC, loin s’en faut, mais je pense qu’ils restent dans l’ombre de sa foi à lui, qu’elle rejaillit sur eux. C’est une chose si peu moderne, si surprenante. L’extrait du Journal d’Huguenin que je citais le 8 avril n’est pas sans rapport avec l’impression que me fait F.
Quand je l’ai revu pour la première fois, à la liturgie de la passion, il avait grossi et n’était plus habillé comme un jeune docteur en théologie mais en pastore. La barbe qu’il s’était laissé pousser lui donnait des airs de Marc-Aurèle. Je trouvais cette allure un peu frustre rassurante.
13 Avril
« Est-il interdit d’imaginer qu’il existe parmi nous au moins un catholique du temps des cathédrales, que sa foi pourrait encore lancer dans une étonnante expédition spirituelle ? »
Les Deux Étendards, Lucien Rebatet
*
En poursuivant la réflexion sur mon avenir, j’en arrive aux conclusions suivantes : de ces trois années parisiennes je n’ai rien fait, tout du moins rien dont je ne puisse tirer une quelconque fierté. Je n’ai brillamment réussi nulle part, ni produit quoique ce soit en marge de mes études. Je ne suis même pas tombée vraiment amoureuse une seule fois ! Je ne me suis pas non plus fait de nouveaux amis, tout juste quelques copines et copains, que le circonstances approchent et éloignent sans que je ne m’en soucis trop. J’en suis à un point où mon retour en Corse me semble plus que jamais gorgé de promesses. D’autant que les cartes ont été rebattues. Dans l’avion deux jeunes de mon âge étaient assis à coté de moi, deux jeunes qui, à l’époque du lycée, ne m’auraient sans doute jamais adressé la parole; cette fois pourtant ils m’ont clairement identifiée comme l’une des leur et ont, durant tout le vol, rivalisé d’attention à mon égard. J’étais épatée.
Tout le monde cherche son lieu naturel et si j’ai trouvé le mien, si je suis sûre de ne jamais pouvoir mener une vie pleine et heureuse ailleurs qu’en Corse, alors pourquoi m’en priver ? pourquoi me refuser ce plaisir ? La liberté qu’offre Paris ne m’intéresse manifestement pas. Les rencontres que j’ai faites ces derniers mois à Bastia me semblent tout aussi enrichissantes que celles faites sur le continent, si ce n’est plus. Je ne vois rationnellement aucune raison de ne pas rentrer, sinon celle de ne pas peiner mes parents, qui, quand je leur parle de mon retour prématuré, sont dépités. Leur réaction me blesse énormément; je sens une déception immense et je la comprends : ils croyaient leur fille brillante, elle s’est révélée quelconque. En voilà une déconvenue. C’est ce qui m’arrête. Je ne me sens pas le droit de les décevoir à ce point. Je me dis : un an de plus, ce n’est pas si terrible et pourtant je suis prise d’un vertige, mon ventre se noue à l’idée de devoir passer douze mois de plus je ne sais où.
16 Avril
Je regarde une vidéo où l’on voit les supporters du SCB arriver à Paris puis au stade. Au-delà du foot, au delà de la finale, c’est l’ivresse de l’entre soi qui rend ces gens si heureux.
Au coeur des tribunes flotte une petite banderole sur laquelle est inscrit « ESSE NOI », comme ça, en lettres capitales. Elle résume bien les choses. Nous déclarons exister envers et contre tout: tel est notre triomphe.
Pourtant, quelques heures plus tard, ce « nous » si fier n’est plus qu’un agrégat de pleureuses vexées par l’attitude méprisante d’un Thiriez — alors même qu’il incarne tout ce que l’on déteste et tout ce dont nous voudrions nous émanciper. Notre susceptibilité trahit cet éternel complexe du colonisé qui dénigre ses maîtres mais n’abandonne pas l’espoir d’un jour parvenir à manger à leur table.
Ce peuple est simultanément sain et moribond, schizophrène.
« Qui trop parole, il se mesfait. » Chrétiens de Troye
Le problème des rapprochements opérés sur la base d’une connivence idéologique, même si ce n’est jamais chez moi qu’un prétexte, puisque je n’accorde pas ma sympathie au premier pourfendeur de la modernité venu, c’est qu’il est parfois malaisé de basculer sur un registre plus intime, plus quotidien.
J’y pense à cause de F., bien sûr, à qui je voudrais parler de tout et de rien, plutôt que d’être cantonnée dans un registre intellectuel ou politique, voire théologique. Je crois que mon absence d’intérêt pour le concept transparait très bien dans ce journal où, après tout, je ne développe que peu d’idées en tant que telles.
L’idéal serait bien sûr de se taire. Deux choses permettent le silence : la proximité physique et la certitude d’avoir avec l’autre un lien indéfectible, peu importe sa nature. C’est un luxe que je connais.
Avec F. j’ai à la fois envie de lui parler, pour lui signifier ma présence, et le sentiment que cette parole continue me trahit, lui donne une image tronquée de moi — sans mentir on en vient toujours à commettre de petites exagérations, des inexactitudes.
Je parle trop et cela me dessert. À très court terme, ces causeries répétitives risquent de l’exaspérer.
19 Juin.
Je sens qu’un important changement s’est produit dans ma vie depuis cette fameuse semaine pascale mais tout, en moi, demeure encore incertain, comme incapable de déterminer ce qu’à présent je suis. Cette incertitude et mon extrême fatigue — liée à ma maladie qui n’en finit plus de revenir — me rendent plus sensible que je ne l’ai jamais été. L’impression d’être sans cesse au bord des larmes, d’avoir un chagrin inconsolable parce qu’indéterminé, sans objet précis et néanmoins capable de surgir pour un rien.
*
Suzanne. Je n’ai encore rien écrit ici, me semble-t-il, de son hospitalisation, de la dégradation de son état de santé. Je suis allée la voir en tout et pour tout trois fois. La première fut la plus éprouvante, j’en ai pleuré pendant des heures. Avant, pendant, après. Quelque chose d’insoutenable à l’idée qu’elle puisse m’oublier, oublier les uns après les autres ceux qui l’aiment jusqu’à sa propre fille, comme ma grand-mère avait en son temps fini par ne plus reconnaitre mon père. Mais surtout, j’ai peur qu’elle se sente seule et perdue, livrée à elle-même dans cet endroit qu’elle identifie mal (l’hôpital qu’elle confond souvent avec l’appartement de Papa ou le village), envahie par ses pensées décousues et angoissantes. Depuis, chaque fois que je pense à elle, je ne peux m’empêcher de pleurer et je pense à elle toutes les nuits. Je suis inconsolable.
La dernière fois que je lui ai rendu visite elle dit à Mattea, me désignant « regarde là, décidément entre nous il y a quelque chose, à chaque fois que je la vois je suis au bord des larmes ». Son sourire fragile. Mon coeur se serrait; j’éprouvais de façon aussi simultanée que paradoxale la crainte de la perdre et la peine de l’avoir comme déjà perdue. Insoutenable. L’effort surhumain qu’il me fallut faire alors pour ne pas éclater en sanglots.
F. a, je crois, une emprise considérable sur les membres d’ICC et je sens son influence s’étendre lentement jusqu’à moi, d’une manière très trouble, disons même retorse. Je sais qu’elle atteint les autres de la même façon, de biais, avec une inflexible douceur. Il ne s’auto-désigne pas comme meneur mais il fait et on le suit, sans même s’en apercevoir.
7 Avril
Il faut que je comprenne bien une chose : dans ce journal, les faits n’ont aucune importance. À trop vouloir ne perdre aucun détail je délaisse mes meilleures intuitions. Tout se bouscule et je ne sais plus par où commencer. Je raconterai cette semaine pascale quand toutes mes pensées se seront misent en ordre.
8 Avril
« Quoi de plus beau qu'un homme grand et vigoureux, aux épaules larges et musclées, aux mâchoires dures, aux lèvres lourdes — et priant Dieu comme un enfant. »
Journal, Jean-René Huguenin.
10 Avril
(...)
Revenons-en à mon avenir. Doit-on toujours acter ses possibilités d’une indéniable et très tangible réussite scolaire ? Toutes nos capacités doivent-elles devenir rentables ? L’autre soir au Wha, quand je mangeais avec J., A. et F., l’un d’eux a mentionné la passion actuelle d’An. pour l’histoire, racontant que ce dernier l’avait doctement entretenu de Pline le Jeune et Pline l’Ancien, bien qu’ivre au dernier degré dans un bar des tréfonds du port de Toga. Voilà : des fois, je ne suis pas sûre de vouloir autre chose que de savantes discussions de comptoir.
Hier soir j’ai parlé de ces hésitations à F.. Je lui ai dit mon sentiment, celui d’être témoin d’un miracle permanent quand je rentrais : ici les gens ne se rendent plus compte de leur bonheur, tous vivent dans une félicité qui leur échappe parce que pour eux elle va de soi. Rien n’est moins naturel mais c’est tout juste si elle n’est pas devenu un dû. Je ne dis pas : les hivers peuvent être longs mais ils ne seront jamais aussi pénibles que ceux d’ailleurs, or c’est une chose que j’ignorais avant de partir.
Je commençais peut-être à m’en douter un peu les dernières années, je me souviens avoir eu des discussions à ce propos avec Ramatou quand nous remontions manger notre panini au lycée. L’air était pur et le ciel sans nuage, le froid glacial et nous étions heureuses. En Corse j’éprouve parfois une joie de vivre qui ne tient à rien d’autre qu’à ma présence physique sur cette île et je crois que c’est un sentiment partagé par beaucoup d’entre nous. D’ailleurs il y a un passage dans Le Principe de Ferrari qui me semble faire état de cette étrange élan du coeur mais je ne crois pas qu’il ait réussi à exploiter pleinement le potentiel incroyable de cette sensation aussi puissante que mystérieuse. À sa décharge, je reconnais volontiers qu’elle est très difficilement descriptible.
« Mon cousin semblait parfois ployer sous un poids énorme qui menaçait de le terrasser, et il lui fallait fuir, peut-être la canicule et l’incessante frénésie estivale, peut-être la migraine, le souvenir de nuits sordides ou quelque chose de plus sombre dont j’ignorais la nature. Il m’emmenait alors en montagne boire un café sur la terrasse d’un gîte d’étape, dans un ancien village de transhumance que traversait un sentier de randonnée. Nous y passions un moment, dans la fraîcheur des fougères, à l’ombre de grands pins. Mais son humeur restait maussade. Il ne m’adressait pas la parole. Nous reprenions sa voiture pour retourner en ville et soudain, sans que rien le laissât prévoir, au détour d’un virage, apparaissait la mer. Nous dominions le paysage, comme si nous étions suspendus dans l’air limpide, au-dessus de la route en lacets dévalant à pic à travers la forêt vers le golfe éblouissant qui s’étendait mille mètres en contrebas. Mon cousin ouvrait de grands yeux sur ce panorama qu’il connaissait depuis son enfance mais semblait découvrir à chaque fois comme si c’était la première. Il faisait une grimace incrédule, se mettait à sourire et me donnait des petits coups de poing sur la cuisse en disant, putain ! quand même, hein ? incapable d’exprimer avec davantage de clarté le sentiment qui le bouleversait et lui rendait aussi instantanément le goût de vivre, dans lequel il n’était pas difficile de reconnaître une curieuse forme d’amour qui aurait pris pour objet, non un autre être humain, mais une petite partie bien déterminée du vaste monde inerte, et dont, quoique je sois moi-même incapable de le ressentir, je devais cependant admettre l’incomparable puissance. »
Le principe, Jérôme Ferrari.
F., donc, me disait s’être pleinement rendu compte de ce bonheur diffus, inouï et constant; c’est justement ce qui l’avait décidé à ne jamais partir. Pour mon cas il ne s’est pas prononcé trop clairement, jugeant la situation complexe, mais m’a enjointe à ne pas prendre ma décision trop vite. On sait tous que les retours sont définitifs, j’en ai bien conscience. Cependant si continuer mes études à distance était possible… J’avoue avoir parler de mes doutes pour vérifier ce que l’évocation de mon éventuel retour suscitait chez lui. C’était idiot. Je ne pense pas lui plaire autrement que d’un point de vue strictement intellectuel, ce qui équivaut à ne pas plaire du tout à homme, j’en conviens, mais j’étais curieuse de voir sa réaction. J’éprouve pour ce type quelque chose d’assez inédit qui n’est pas une attirance franche, bestiale, à la façon dont un L. pourrait m’attirer (et, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, je reconnais que sa laideur m’attire peut-être plus que sa « beauté enfouie » dont je parlais la dernière fois). F. m’impressionne par la profondeur et l’intensité de sa vie spirituelle qui le coupe radicalement des autres. Il nous, ou disons il les entraine dans son sillage mais s’en retrouve, de fait, loin devant, seul. Je ne sais pas s’il s’est rendu compte qu’il les portait tous à bout de bras. Entendons nous bien, je ne remets pas en cause la croyance des membres d’ICC, loin s’en faut, mais je pense qu’ils restent dans l’ombre de sa foi à lui, qu’elle rejaillit sur eux. C’est une chose si peu moderne, si surprenante. L’extrait du Journal d’Huguenin que je citais le 8 avril n’est pas sans rapport avec l’impression que me fait F.
Quand je l’ai revu pour la première fois, à la liturgie de la passion, il avait grossi et n’était plus habillé comme un jeune docteur en théologie mais en pastore. La barbe qu’il s’était laissé pousser lui donnait des airs de Marc-Aurèle. Je trouvais cette allure un peu frustre rassurante.
13 Avril
« Est-il interdit d’imaginer qu’il existe parmi nous au moins un catholique du temps des cathédrales, que sa foi pourrait encore lancer dans une étonnante expédition spirituelle ? »
Les Deux Étendards, Lucien Rebatet
*
En poursuivant la réflexion sur mon avenir, j’en arrive aux conclusions suivantes : de ces trois années parisiennes je n’ai rien fait, tout du moins rien dont je ne puisse tirer une quelconque fierté. Je n’ai brillamment réussi nulle part, ni produit quoique ce soit en marge de mes études. Je ne suis même pas tombée vraiment amoureuse une seule fois ! Je ne me suis pas non plus fait de nouveaux amis, tout juste quelques copines et copains, que le circonstances approchent et éloignent sans que je ne m’en soucis trop. J’en suis à un point où mon retour en Corse me semble plus que jamais gorgé de promesses. D’autant que les cartes ont été rebattues. Dans l’avion deux jeunes de mon âge étaient assis à coté de moi, deux jeunes qui, à l’époque du lycée, ne m’auraient sans doute jamais adressé la parole; cette fois pourtant ils m’ont clairement identifiée comme l’une des leur et ont, durant tout le vol, rivalisé d’attention à mon égard. J’étais épatée.
Tout le monde cherche son lieu naturel et si j’ai trouvé le mien, si je suis sûre de ne jamais pouvoir mener une vie pleine et heureuse ailleurs qu’en Corse, alors pourquoi m’en priver ? pourquoi me refuser ce plaisir ? La liberté qu’offre Paris ne m’intéresse manifestement pas. Les rencontres que j’ai faites ces derniers mois à Bastia me semblent tout aussi enrichissantes que celles faites sur le continent, si ce n’est plus. Je ne vois rationnellement aucune raison de ne pas rentrer, sinon celle de ne pas peiner mes parents, qui, quand je leur parle de mon retour prématuré, sont dépités. Leur réaction me blesse énormément; je sens une déception immense et je la comprends : ils croyaient leur fille brillante, elle s’est révélée quelconque. En voilà une déconvenue. C’est ce qui m’arrête. Je ne me sens pas le droit de les décevoir à ce point. Je me dis : un an de plus, ce n’est pas si terrible et pourtant je suis prise d’un vertige, mon ventre se noue à l’idée de devoir passer douze mois de plus je ne sais où.
16 Avril
Je regarde une vidéo où l’on voit les supporters du SCB arriver à Paris puis au stade. Au-delà du foot, au delà de la finale, c’est l’ivresse de l’entre soi qui rend ces gens si heureux.
Au coeur des tribunes flotte une petite banderole sur laquelle est inscrit « ESSE NOI », comme ça, en lettres capitales. Elle résume bien les choses. Nous déclarons exister envers et contre tout: tel est notre triomphe.
Pourtant, quelques heures plus tard, ce « nous » si fier n’est plus qu’un agrégat de pleureuses vexées par l’attitude méprisante d’un Thiriez — alors même qu’il incarne tout ce que l’on déteste et tout ce dont nous voudrions nous émanciper. Notre susceptibilité trahit cet éternel complexe du colonisé qui dénigre ses maîtres mais n’abandonne pas l’espoir d’un jour parvenir à manger à leur table.
Ce peuple est simultanément sain et moribond, schizophrène.
« Qui trop parole, il se mesfait. » Chrétiens de Troye
Le problème des rapprochements opérés sur la base d’une connivence idéologique, même si ce n’est jamais chez moi qu’un prétexte, puisque je n’accorde pas ma sympathie au premier pourfendeur de la modernité venu, c’est qu’il est parfois malaisé de basculer sur un registre plus intime, plus quotidien.
J’y pense à cause de F., bien sûr, à qui je voudrais parler de tout et de rien, plutôt que d’être cantonnée dans un registre intellectuel ou politique, voire théologique. Je crois que mon absence d’intérêt pour le concept transparait très bien dans ce journal où, après tout, je ne développe que peu d’idées en tant que telles.
L’idéal serait bien sûr de se taire. Deux choses permettent le silence : la proximité physique et la certitude d’avoir avec l’autre un lien indéfectible, peu importe sa nature. C’est un luxe que je connais.
Avec F. j’ai à la fois envie de lui parler, pour lui signifier ma présence, et le sentiment que cette parole continue me trahit, lui donne une image tronquée de moi — sans mentir on en vient toujours à commettre de petites exagérations, des inexactitudes.
Je parle trop et cela me dessert. À très court terme, ces causeries répétitives risquent de l’exaspérer.
19 Juin.
Je sens qu’un important changement s’est produit dans ma vie depuis cette fameuse semaine pascale mais tout, en moi, demeure encore incertain, comme incapable de déterminer ce qu’à présent je suis. Cette incertitude et mon extrême fatigue — liée à ma maladie qui n’en finit plus de revenir — me rendent plus sensible que je ne l’ai jamais été. L’impression d’être sans cesse au bord des larmes, d’avoir un chagrin inconsolable parce qu’indéterminé, sans objet précis et néanmoins capable de surgir pour un rien.
*
Suzanne. Je n’ai encore rien écrit ici, me semble-t-il, de son hospitalisation, de la dégradation de son état de santé. Je suis allée la voir en tout et pour tout trois fois. La première fut la plus éprouvante, j’en ai pleuré pendant des heures. Avant, pendant, après. Quelque chose d’insoutenable à l’idée qu’elle puisse m’oublier, oublier les uns après les autres ceux qui l’aiment jusqu’à sa propre fille, comme ma grand-mère avait en son temps fini par ne plus reconnaitre mon père. Mais surtout, j’ai peur qu’elle se sente seule et perdue, livrée à elle-même dans cet endroit qu’elle identifie mal (l’hôpital qu’elle confond souvent avec l’appartement de Papa ou le village), envahie par ses pensées décousues et angoissantes. Depuis, chaque fois que je pense à elle, je ne peux m’empêcher de pleurer et je pense à elle toutes les nuits. Je suis inconsolable.
La dernière fois que je lui ai rendu visite elle dit à Mattea, me désignant « regarde là, décidément entre nous il y a quelque chose, à chaque fois que je la vois je suis au bord des larmes ». Son sourire fragile. Mon coeur se serrait; j’éprouvais de façon aussi simultanée que paradoxale la crainte de la perdre et la peine de l’avoir comme déjà perdue. Insoutenable. L’effort surhumain qu’il me fallut faire alors pour ne pas éclater en sanglots.
mercredi 7 octobre 2015
Journal
26 Décembre 2014
Cette année encore nous sommes allés à la messe de six heure, mon père, ma tante et moi. L’église était si pleine que nous avons du rester sur le parvis, en compagnie d’une grosse cinquantaine d’autres personnes, toutes assez jeunes, avec des enfants souvent. En Corse la foi n’a pas besoin de l’Église, il suffit de regarder autour de soi pour être à nouveau subjugué ou carrément converti; mais le catholicisme doit redevenir un combat culturel, ici, comme partout en Europe du reste, il est nécessaire que les églises se remplissent. Ma tante m’a dit qu’une telle affluence était certes exceptionnelle mais que, le dimanche, il y avait toujours beaucoup de monde. J’en étais ravie.
L’an dernier déjà j’avais adoré regarder les gens. C’est bien pour le plaisir des yeux que je raffole des rassemblements. Parfois j’observe les corses comme si je ne l’étais pas. À force de chercher à définir notre identité j’ai l’impression de m’en éloigner, de perdre mon rapport immédiat, spontané à ma nature…
Quoiqu’il en soit, ce soir là, j’étais tout contre la porte de l’Eglise et devant moi il y avait un jeune homme très beau, seul. Des vieilles lui ont demandé s’il était d’ici, il a répondu du Fiumorbu. J’étais littéralement fascinée par lui. Je me demandais ce qu’il faisait là, il ne semblait connaître personne et n’avait pas l’air vantard des jeunes porto-vecchiais. Il détonnait, en somme.
L’ayant vu de face j’avais remarqué sa chaine en or, un peu épaisse, qui, si je l’avais vue sur un quelconque français m’aurait sans doute parue vulgaire. Elle me rappelait étrangement celle aperçue sur F., pourtant très fine mais excessivement brillante — à laquelle était peut-être accrochée une petite médaille miraculeuse. D’ailleurs lui aussi avait les yeux bleus et un nez aquilin. À croire que je remarque toujours le même genre d’homme, comme si j’en cherchais un très précis au sein d’un groupe éminemment restreint.
À notre retour chez tatie Claire nous nous sommes faits traités de grenouilles de bénitier, bien sûr, mais ils n’osent jamais se moquer de mon père bien longtemps, aussi les remarques ont vite cessé.
Au cours du diner, mon père se tourne vers ma mère et lui dit « regarde ta fille comme elle est belle », « magnifique » s’exclame alors ma tante Michèle tandis que ma mère, elle, reste coite. C’était pour moi un moment très gênant.
À part ça les deux jours se sont déroulés comme à l’accoutumée et j’ai encore été très gâtée.
29 Décembre
« Les hommes cherchent uniquement à se faire sucer
la queue
Autant d’heures dans la journée que possible
Par autant de jolies filles que possible.
En dehors de cela, ils s’intéressent aux problèmes
techniques.
Est-ce suffisamment clair ? »
Les Hommes (Configuration du Dernier Rivage), Michel Houellebecq.
Hier je pensais encore à toute cette histoire. Je marchais de long en large dans ma chambre, j’attrape ce livre au hasard, l’ouvre et tombe pile sur ce poème. Le « est-ce suffisamment clair ? » semblait m’être personnellement adressé, comme une injonction à surmonter mon trouble.
30 Décembre
9h52, G. qui m’envoie : « bisous ». Ce type est une blague. Une grosse blague. La meilleure blague de l’année. Je raconte ça à Thomas, il me dit : t’aurais dû lui répondre « tu veux pas une photo d’abord ? ». J’ai ri.
L’espace d’un instant, l’idée qu’il ait pu se tromper de destinataire et que ce bisous matinal fut originellement destiné à sa nouvelle conquête m’a traversée l’esprit, je dois bien le reconnaître.
13 Janvier
« Dans un éditorial, le Global Times, un des journaux du Parti communiste chinois (PCC), a jugé que les marches dimanche de millions de manifestants descendus dans la rue avec une cinquantaine de dirigeants étrangers "ne devraient guère produire de résultats significatifs". "Malgré son échelle impressionnante, la marche de Paris dimanche faisait songer à la mise sous antalgiques d'un malade gravement atteint", écrivait le journal. "Ce que les sociétés occidentales développées traversent, c'est le prix de leurs actes historiques d'esclavage et de colonialisme qui ont conduit à leur démographie actuelle", poursuit le journal, au ton volontiers nationaliste.»
13/01/2015, Pékin (AFP)
À la veille de la manifestation nous avons finalement décidés d’y aller. D. et moi espérions cyniquement que les choses dérapent et voir l’Histoire se mettre enfin en marche; nous n’avons hélas trouvé qu’un peuple étonnement silencieux, hagard, idiot. Un peuple comique à force d’inconscience, aussi. Ils opposent des symboles à des attaques, comme on enverrait une colombe à quelqu’un qui s’arme et vous déclare la guerre. Dans un café, une femme assise à coté de nous se disait incapable de comprendre cette tuerie… « nous vivions pourtant en paix depuis si longtemps »… À ces mots, ni une ni deux, il aurait fallu la gifler sur place, c’est tout. Tant que la guerre n’a pas lieu sur le pas de leur porte ces cons ne la voient pas. Nous n’avons jamais cessé de faire la guerre, nous l’avons seulement délocalisée — par nous j’entends l’occident. Dans nos esprits la guerre n’est plus concrète, elle n’est qu’un mot épouvantail, une figure abstraite du Mal. À la télé des gens disaient même « la france ne méritait pas ça ! », voilà bien une autre preuve de notre terrible inconscience : la France ne méritait effectivement pas ça, elle méritait pire encore.
En somme, donc, l’ambiance de la marche du 11 Janvier était à la fois grave et bouffonne; grave parce qu’une nouvelle ère s’ouvre, nous ne reviendrons plus en arrière et tout ira de mal en pis, mais bouffonne parce que l’immense majorité ne l’a pas encore compris.
Autre chose : la nuit avant la manifestation L. m’a envoyé un message (era ora !) et nous avons parlé pendant près de trois heures. Je dois dire que le type est épatant. On le sent malin. Un détail, par exemple : je lui demandais s’il connaissait Jünger, il m’a répondu quelque chose comme « évidement ma chère, j’ai une demi-douzaine de Jünger dans ma bibliothèque et sa biographie par Venner ». Une demie douzaine… Ça ne fait jamais que six, mais dit comme ça, on dirait qu’il en a une étagère pleine. Et il est sur certains sujets fort subtil, ses avis sont mesurés, il ne tombe dans aucun cliché.
Autant se l’avouer maintenant : je me sens très attirée par lui, d’une façon toute physique. Je me souviens l’avoir à plusieurs reprises croisé l’été dernier, à l’Albert et à l’Idéal, je ressentais déjà cette attirance mêlée d’un brin de répulsion. Mais tout cela est toujours très incertain. J’en reparlerai si les choses évoluent ou persistent.
16 Janvier
Revue des images de la manifestation. L’endroit où nous nous trouvions était plutôt calme au regard d’autres clairement gagnés par l’hystérie collective.
Je crois mieux comprendre l’origine de ma gêne face au comportement de cette foule: pour moi ses idoles (la laïcité, la liberté d’expression, la liberté tout court) sont parfaitement obsolètes, et si demain quelqu’un se mettait à vénérer le poisson pané tout le monde le prendrait, à raison sans doute, pour un fou; or, ces gens me font précisément l’effet d’adorateurs de poisson pané paniqués à l’idée que leur foi puisse être remise en question par une autre, radicalement différente, incompatible avec leur logiciel, au point d’être considérée par eux comme une fantaisie immature, un simple caprice. Mais si pour le moderne la religion est un enfantillage, pour le croyant les dogmes occidentaux sont d’horribles dévoiements. Je pense qu’aucun dialogue n’est possible entre un laïcard convaincu et un croyant sincère. C’est bien parce que le catholicisme est mort, ou dans le meilleur des cas toujours en réparation, que nous parvenons à vivre dans un tel monde sans que celui-ci ne nous soulève le coeur à chaque instant. Même ceux conscients de la décadence n’ont pas les moyens de s’opposer à elle car sans foi nous n’avons plus la force de défendre nos valeurs, nos traditions : elles ne peuvent faire sens qu’en perspective de cette ultime transcendance. Sans Dieu tout est relatif, tout se vaut. Si révolte contre le monde moderne il y a, elle ne peut naître que d’un élan profondément religieux. J’en suis convaincue.
Tout se joue donc entre des athées laïcs qui se comportent comme des dévots (qui finiront sans doute, du reste, croyants malgré eux), des catholiques de culture, mou et sans foi, et un islam encore sûr de lui avec des velléités expansionnistes.
« Nous pensons d’ailleurs qu’une tradition occidentale, si elle parvenait à se reconstituer, prendrait forcément une forme extérieure religieuse, au sens le plus strict de ce mot, et que cette forme ne pourrait être que chrétienne, car, d’une part, les autres formes possibles sont depuis trop longtemps étrangères à la mentalité occidentale, et, d’autre part, c’est dans le Christianisme seul, disons plus précisément encore dans le Catholicisme, que se trouvent, en Occident, les restes d’esprit traditionnel qui survivent encore. Toute tentative “traditionaliste” qui ne tient pas compte de ce fait est inévitablement vouée à l’insuccès, parce qu’elle manque de base ; il est trop évident qu’on ne peut s’appuyer que sur ce qui existe d’une façon effective, et que, là où la continuité fait défaut, il ne peut y avoir que des reconstitutions artificielles et qui ne sauraient être viables ; si l’on objecte que le Christianisme même, à notre époque, n’est plus guère compris vraiment et dans son sens profond, nous répondrons qu’il a du moins gardé, dans sa forme même, tout ce qui est nécessaire pour fournir la base dont il s’agit. La tentative la moins chimérique, la seule même qui ne se heurte pas à des impossibilités immédiates, serait donc celle qui viserait à restaurer quelque chose de comparable à ce qui exista au moyen âge, avec les différences requises par la modification des circonstances ; et, pour tout ce qui est entièrement perdu en Occident, il conviendrait de faire appel aux traditions qui se sont conservées intégralement, comme nous l’indiquions tout à l’heure, et d’accomplir ensuite un travail d’adaptation qui ne pourrait être que l’œuvre d’une élite intellectuelle fortement constituée. Tout cela, nous l’avons déjà dit ; mais il est bon d’y insister encore, parce que trop de rêveries inconsistantes se donnent libre cours actuellement, et aussi parce qu’il faut bien comprendre que, si les traditions orientales, dans leurs formes propres, peuvent assurément être assimilées par une élite qui, par définition en quelque sorte, doit être au-delà de toutes les formes, elles ne pourront sans doute jamais l’être, à moins de transformations imprévues, par la généralité des Occidentaux, pour qui elles n’ont point été faites. Si une élite occidentale arrive à se former, la connaissance vraie des doctrines orientales, pour la raison que nous venons d’indiquer, lui sera indispensable pour remplir sa fonction ; mais ceux qui n’auront qu’à recueillir le bénéfice de son travail, et qui seront le plus grand nombre pourront fort bien n’avoir aucune conscience de ces choses, et l’influence qu’ils en recevront, pour ainsi dire sans s’en douter et en tout cas par des moyens qui leur échapperont entièrement, n’en sera pas pour cela moins réelle ni moins efficace. Nous n’avons jamais dit autre chose ; mais nous avons cru devoir le répéter ici aussi nettement que possible, parce que, si nous devons nous attendre à ne pas être toujours entièrement compris par tous, nous tenons du moins à ce qu’on ne nous attribue pas des intentions qui ne sont aucunement les nôtres. »
La crise du Monde Moderne, René Guénon
Cette année encore nous sommes allés à la messe de six heure, mon père, ma tante et moi. L’église était si pleine que nous avons du rester sur le parvis, en compagnie d’une grosse cinquantaine d’autres personnes, toutes assez jeunes, avec des enfants souvent. En Corse la foi n’a pas besoin de l’Église, il suffit de regarder autour de soi pour être à nouveau subjugué ou carrément converti; mais le catholicisme doit redevenir un combat culturel, ici, comme partout en Europe du reste, il est nécessaire que les églises se remplissent. Ma tante m’a dit qu’une telle affluence était certes exceptionnelle mais que, le dimanche, il y avait toujours beaucoup de monde. J’en étais ravie.
L’an dernier déjà j’avais adoré regarder les gens. C’est bien pour le plaisir des yeux que je raffole des rassemblements. Parfois j’observe les corses comme si je ne l’étais pas. À force de chercher à définir notre identité j’ai l’impression de m’en éloigner, de perdre mon rapport immédiat, spontané à ma nature…
Quoiqu’il en soit, ce soir là, j’étais tout contre la porte de l’Eglise et devant moi il y avait un jeune homme très beau, seul. Des vieilles lui ont demandé s’il était d’ici, il a répondu du Fiumorbu. J’étais littéralement fascinée par lui. Je me demandais ce qu’il faisait là, il ne semblait connaître personne et n’avait pas l’air vantard des jeunes porto-vecchiais. Il détonnait, en somme.
L’ayant vu de face j’avais remarqué sa chaine en or, un peu épaisse, qui, si je l’avais vue sur un quelconque français m’aurait sans doute parue vulgaire. Elle me rappelait étrangement celle aperçue sur F., pourtant très fine mais excessivement brillante — à laquelle était peut-être accrochée une petite médaille miraculeuse. D’ailleurs lui aussi avait les yeux bleus et un nez aquilin. À croire que je remarque toujours le même genre d’homme, comme si j’en cherchais un très précis au sein d’un groupe éminemment restreint.
À notre retour chez tatie Claire nous nous sommes faits traités de grenouilles de bénitier, bien sûr, mais ils n’osent jamais se moquer de mon père bien longtemps, aussi les remarques ont vite cessé.
Au cours du diner, mon père se tourne vers ma mère et lui dit « regarde ta fille comme elle est belle », « magnifique » s’exclame alors ma tante Michèle tandis que ma mère, elle, reste coite. C’était pour moi un moment très gênant.
À part ça les deux jours se sont déroulés comme à l’accoutumée et j’ai encore été très gâtée.
29 Décembre
« Les hommes cherchent uniquement à se faire sucer
la queue
Autant d’heures dans la journée que possible
Par autant de jolies filles que possible.
En dehors de cela, ils s’intéressent aux problèmes
techniques.
Est-ce suffisamment clair ? »
Les Hommes (Configuration du Dernier Rivage), Michel Houellebecq.
Hier je pensais encore à toute cette histoire. Je marchais de long en large dans ma chambre, j’attrape ce livre au hasard, l’ouvre et tombe pile sur ce poème. Le « est-ce suffisamment clair ? » semblait m’être personnellement adressé, comme une injonction à surmonter mon trouble.
30 Décembre
9h52, G. qui m’envoie : « bisous ». Ce type est une blague. Une grosse blague. La meilleure blague de l’année. Je raconte ça à Thomas, il me dit : t’aurais dû lui répondre « tu veux pas une photo d’abord ? ». J’ai ri.
L’espace d’un instant, l’idée qu’il ait pu se tromper de destinataire et que ce bisous matinal fut originellement destiné à sa nouvelle conquête m’a traversée l’esprit, je dois bien le reconnaître.
13 Janvier
« Dans un éditorial, le Global Times, un des journaux du Parti communiste chinois (PCC), a jugé que les marches dimanche de millions de manifestants descendus dans la rue avec une cinquantaine de dirigeants étrangers "ne devraient guère produire de résultats significatifs". "Malgré son échelle impressionnante, la marche de Paris dimanche faisait songer à la mise sous antalgiques d'un malade gravement atteint", écrivait le journal. "Ce que les sociétés occidentales développées traversent, c'est le prix de leurs actes historiques d'esclavage et de colonialisme qui ont conduit à leur démographie actuelle", poursuit le journal, au ton volontiers nationaliste.»
13/01/2015, Pékin (AFP)
À la veille de la manifestation nous avons finalement décidés d’y aller. D. et moi espérions cyniquement que les choses dérapent et voir l’Histoire se mettre enfin en marche; nous n’avons hélas trouvé qu’un peuple étonnement silencieux, hagard, idiot. Un peuple comique à force d’inconscience, aussi. Ils opposent des symboles à des attaques, comme on enverrait une colombe à quelqu’un qui s’arme et vous déclare la guerre. Dans un café, une femme assise à coté de nous se disait incapable de comprendre cette tuerie… « nous vivions pourtant en paix depuis si longtemps »… À ces mots, ni une ni deux, il aurait fallu la gifler sur place, c’est tout. Tant que la guerre n’a pas lieu sur le pas de leur porte ces cons ne la voient pas. Nous n’avons jamais cessé de faire la guerre, nous l’avons seulement délocalisée — par nous j’entends l’occident. Dans nos esprits la guerre n’est plus concrète, elle n’est qu’un mot épouvantail, une figure abstraite du Mal. À la télé des gens disaient même « la france ne méritait pas ça ! », voilà bien une autre preuve de notre terrible inconscience : la France ne méritait effectivement pas ça, elle méritait pire encore.
En somme, donc, l’ambiance de la marche du 11 Janvier était à la fois grave et bouffonne; grave parce qu’une nouvelle ère s’ouvre, nous ne reviendrons plus en arrière et tout ira de mal en pis, mais bouffonne parce que l’immense majorité ne l’a pas encore compris.
Autre chose : la nuit avant la manifestation L. m’a envoyé un message (era ora !) et nous avons parlé pendant près de trois heures. Je dois dire que le type est épatant. On le sent malin. Un détail, par exemple : je lui demandais s’il connaissait Jünger, il m’a répondu quelque chose comme « évidement ma chère, j’ai une demi-douzaine de Jünger dans ma bibliothèque et sa biographie par Venner ». Une demie douzaine… Ça ne fait jamais que six, mais dit comme ça, on dirait qu’il en a une étagère pleine. Et il est sur certains sujets fort subtil, ses avis sont mesurés, il ne tombe dans aucun cliché.
Autant se l’avouer maintenant : je me sens très attirée par lui, d’une façon toute physique. Je me souviens l’avoir à plusieurs reprises croisé l’été dernier, à l’Albert et à l’Idéal, je ressentais déjà cette attirance mêlée d’un brin de répulsion. Mais tout cela est toujours très incertain. J’en reparlerai si les choses évoluent ou persistent.
16 Janvier
Revue des images de la manifestation. L’endroit où nous nous trouvions était plutôt calme au regard d’autres clairement gagnés par l’hystérie collective.
Je crois mieux comprendre l’origine de ma gêne face au comportement de cette foule: pour moi ses idoles (la laïcité, la liberté d’expression, la liberté tout court) sont parfaitement obsolètes, et si demain quelqu’un se mettait à vénérer le poisson pané tout le monde le prendrait, à raison sans doute, pour un fou; or, ces gens me font précisément l’effet d’adorateurs de poisson pané paniqués à l’idée que leur foi puisse être remise en question par une autre, radicalement différente, incompatible avec leur logiciel, au point d’être considérée par eux comme une fantaisie immature, un simple caprice. Mais si pour le moderne la religion est un enfantillage, pour le croyant les dogmes occidentaux sont d’horribles dévoiements. Je pense qu’aucun dialogue n’est possible entre un laïcard convaincu et un croyant sincère. C’est bien parce que le catholicisme est mort, ou dans le meilleur des cas toujours en réparation, que nous parvenons à vivre dans un tel monde sans que celui-ci ne nous soulève le coeur à chaque instant. Même ceux conscients de la décadence n’ont pas les moyens de s’opposer à elle car sans foi nous n’avons plus la force de défendre nos valeurs, nos traditions : elles ne peuvent faire sens qu’en perspective de cette ultime transcendance. Sans Dieu tout est relatif, tout se vaut. Si révolte contre le monde moderne il y a, elle ne peut naître que d’un élan profondément religieux. J’en suis convaincue.
Tout se joue donc entre des athées laïcs qui se comportent comme des dévots (qui finiront sans doute, du reste, croyants malgré eux), des catholiques de culture, mou et sans foi, et un islam encore sûr de lui avec des velléités expansionnistes.
« Nous pensons d’ailleurs qu’une tradition occidentale, si elle parvenait à se reconstituer, prendrait forcément une forme extérieure religieuse, au sens le plus strict de ce mot, et que cette forme ne pourrait être que chrétienne, car, d’une part, les autres formes possibles sont depuis trop longtemps étrangères à la mentalité occidentale, et, d’autre part, c’est dans le Christianisme seul, disons plus précisément encore dans le Catholicisme, que se trouvent, en Occident, les restes d’esprit traditionnel qui survivent encore. Toute tentative “traditionaliste” qui ne tient pas compte de ce fait est inévitablement vouée à l’insuccès, parce qu’elle manque de base ; il est trop évident qu’on ne peut s’appuyer que sur ce qui existe d’une façon effective, et que, là où la continuité fait défaut, il ne peut y avoir que des reconstitutions artificielles et qui ne sauraient être viables ; si l’on objecte que le Christianisme même, à notre époque, n’est plus guère compris vraiment et dans son sens profond, nous répondrons qu’il a du moins gardé, dans sa forme même, tout ce qui est nécessaire pour fournir la base dont il s’agit. La tentative la moins chimérique, la seule même qui ne se heurte pas à des impossibilités immédiates, serait donc celle qui viserait à restaurer quelque chose de comparable à ce qui exista au moyen âge, avec les différences requises par la modification des circonstances ; et, pour tout ce qui est entièrement perdu en Occident, il conviendrait de faire appel aux traditions qui se sont conservées intégralement, comme nous l’indiquions tout à l’heure, et d’accomplir ensuite un travail d’adaptation qui ne pourrait être que l’œuvre d’une élite intellectuelle fortement constituée. Tout cela, nous l’avons déjà dit ; mais il est bon d’y insister encore, parce que trop de rêveries inconsistantes se donnent libre cours actuellement, et aussi parce qu’il faut bien comprendre que, si les traditions orientales, dans leurs formes propres, peuvent assurément être assimilées par une élite qui, par définition en quelque sorte, doit être au-delà de toutes les formes, elles ne pourront sans doute jamais l’être, à moins de transformations imprévues, par la généralité des Occidentaux, pour qui elles n’ont point été faites. Si une élite occidentale arrive à se former, la connaissance vraie des doctrines orientales, pour la raison que nous venons d’indiquer, lui sera indispensable pour remplir sa fonction ; mais ceux qui n’auront qu’à recueillir le bénéfice de son travail, et qui seront le plus grand nombre pourront fort bien n’avoir aucune conscience de ces choses, et l’influence qu’ils en recevront, pour ainsi dire sans s’en douter et en tout cas par des moyens qui leur échapperont entièrement, n’en sera pas pour cela moins réelle ni moins efficace. Nous n’avons jamais dit autre chose ; mais nous avons cru devoir le répéter ici aussi nettement que possible, parce que, si nous devons nous attendre à ne pas être toujours entièrement compris par tous, nous tenons du moins à ce qu’on ne nous attribue pas des intentions qui ne sont aucunement les nôtres. »
La crise du Monde Moderne, René Guénon
mardi 28 juillet 2015
Je me souviens du temps où la fin des bals me semblait être tout ce qu'il y a de plus angoissant. Aujourd'hui j'observe ça avec plus de tendresse. Le regard vague des types saouls, leur solitude un peu navrée. Les vieux qui espèrent rester jeune.
Je dis à Laura "ça ne t'arrive jamais de regretter de ne pas être vulgaire ?"; je lui demande ça les yeux rivés sur des filles oranges aux cheveux blonds décolorés. Il y en a une à qui il manque une dent. Leur vie à l'air simple, on sent qu'elles se trouvent belles. Laura me répond "des fois, mais ça me passe vite"; à moi aussi.
*
Finalement je ne pars plus à Rome. J'ai été malade cinq mois. On m'a dit que le diagnostique posé il y a cinq ans n'était pas le bon, que l'on ne savait pas ce que j'avais. Je n'ai pas pris ma décision immédiatement. Je suis restée très contrariée deux ou trois semaines, j'ai beaucoup pleuré et le déclic s'est fait. Je me suis immédiatement sentie mieux. Je ne regrette pas de rester à Paris l'an prochain. Tout me prouve que j'ai pris la bonne décision. Ce nouvel appartement génial, inespéré, mon enthousiasme retrouvé pour mes études. J'aimerai que les trois prochaines années soient plus productives, et je ne doute pas qu'elles le seront.
*
Je dis à Laura "ça ne t'arrive jamais de regretter de ne pas être vulgaire ?"; je lui demande ça les yeux rivés sur des filles oranges aux cheveux blonds décolorés. Il y en a une à qui il manque une dent. Leur vie à l'air simple, on sent qu'elles se trouvent belles. Laura me répond "des fois, mais ça me passe vite"; à moi aussi.
*
Finalement je ne pars plus à Rome. J'ai été malade cinq mois. On m'a dit que le diagnostique posé il y a cinq ans n'était pas le bon, que l'on ne savait pas ce que j'avais. Je n'ai pas pris ma décision immédiatement. Je suis restée très contrariée deux ou trois semaines, j'ai beaucoup pleuré et le déclic s'est fait. Je me suis immédiatement sentie mieux. Je ne regrette pas de rester à Paris l'an prochain. Tout me prouve que j'ai pris la bonne décision. Ce nouvel appartement génial, inespéré, mon enthousiasme retrouvé pour mes études. J'aimerai que les trois prochaines années soient plus productives, et je ne doute pas qu'elles le seront.
*
Inscription à :
Articles (Atom)